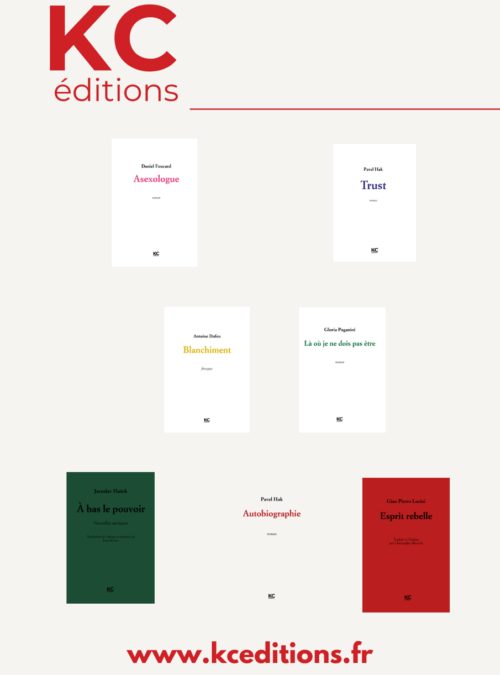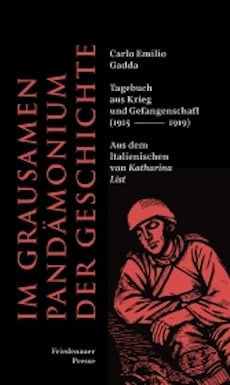Entretien avec Miguel Ángel Cuevas, poète, italianiste et traducteur de Petrolio de Pier Paolo Pasolini
Auteur: Paolo Grossi

Miguel Ángel Cuevas (Alicante, Espagne, 1958) est poète et traducteur. Professeur titulaire d’italien à l’université de Séville, il a édité des textes italiens du XXe siècle (Pirandello, Tozzi, Buzzati, Lampedusa, Pasolini, Consolo, Attanasio, Scandurra, Maraini) et traduit en italien des poètes espagnols contemporains. Depuis 2005, il publie ses propres œuvres poétiques en Italie (toujours en édition bilingue autotraduite) : 47 frammenti (2005), Scrivere l’incàvo (2011), Pietra – e cruda (2015), Sibilo (2015), Ultima fragmenta (2017), Postuma (2021 ; finaliste du prix Montano 2022), Traccia (2024 ; finaliste du prix Montano 2024, prix Gozzano 2025), Seconda forma di Manto (2024). Toujours en 2024, est paru Triptyque, édition trilingue espagnol-italien-français (trad. de Michèle Gendreau-Massaloux et Marc Cheymol) de Scrivere l’incàvo, Pietra – e cruda et Postuma. Aporia, suite de neuf fragments courts, a reçu le prix Montano 2025. Deux de ses poèmes ont été mis en musique par Etta Scollo dans l’album Il passo interiore (2018). Auteur d’essais sur les relations entre la littérature et les arts figuratifs, il collabore à des initiatives d’exposition d’artistes contemporains en Italie et en Espagne (Rotelli, Lanfredini, Casagrande, Granaroli, Santacroce, Manzi, Navamuel).
Poète, professeur de langues romanes à l’université de Séville, italianiste, traducteur, le dialogue entre les langues semble constituer le thème central de votre activité multiforme. Comment ces différentes composantes coexistent-elles dans votre pratique concrète d’enseignant et d’écrivain ?
Je reformulerais légèrement les termes de la question. Dans le passé, j’ai effectivement enseigné la littérature espagnole en Italie (en Sicile, dont l’histoire politique et culturelle tourmentée a marqué mon parcours humain et intellectuel), ainsi que la langue catalane en Espagne, mais depuis près de quarante ans, je m’occupe exclusivement de littérature italienne. J’ai également travaillé pendant des années (celles de mon doctorat) sur un écrivain que l’on pourrait qualifier, plus que de bilingue, de translingue : Jose María Blanco White, qui a exercé son art entre deux langues, le castillan et l’anglais, mais (comme l’a heureusement dit Édouard Glissant à la fin du siècle dernier) « en présence de toutes les langues » : sa figure étant l’une des plus éminentes de l’intelligentsia européenne du début du XIXe siècle. Mon expérience, elle aussi, a nécessairement dû se construire entre plusieurs langues et en présence de plusieurs langues. Bien que je me concentre, en tant que professeur et traducteur, sur la littérature italienne (même si je traduis parfois de l’espagnol vers l’italien, comme je l’ai fait, par exemple, avec l’œuvre de José Ángel Valente), je ne peux m’y approcher que dans le cadre de la culture européenne.
Il convient de tenir un discours légèrement différent (décalé, voire quelque peu déroutant) sur mon écriture poétique, qui se déroule depuis une vingtaine d’années parallèlement en castillan et en italien : ou plutôt, entre ces deux langues, et en présence simultanée des deux.
Face à ce type d’écriture, on parle généralement d’autotraduction ; mais je parlerais plutôt d’une écriture double, dédoublée, mais finalement, sait-on jamais si elle est aboutie… : une écriture qui se reflète dans l’autre, qui échange mutuellement avec l’autre le rôle d’original et de version (terme que je préfère à celui de « traduction »), faisant ainsi disparaître la notion d’« original » et la remplaçant par celle de mouvement « originel » vers l’écriture : qui trouve, si tant est, enfin sa propre signature précisément dans l’échange et le reflet, justement, translinguistiques.
De manière évidente, mais aussi inévitable, la perspective à partir de laquelle je considère l’écriture, la mienne et celle des autres, fonde mon approche tant de la traduction de textes d’autrui que de la pratique de l’enseignement et de la recherche universitaire.
La littérature italienne occupe une place privilégiée dans vos intérêts professionnels. Vers quels siècles et quels auteurs vous orientez-vous en particulier ?
La littérature italienne est en effet au centre de mes intérêts, le pivot autour duquel je gravite : en tant qu’enseignant, traducteur, lecteur, écrivain. J’ai donné pendant des décennies des cours de littérature du XVe siècle, et Angelo Poliziano (que j’ai voulu lire dans une optique déconstructiviste, comme le poète animé par une aspiration, ardente et toujours inassouvie, au dire poétique) m’a laissé une empreinte indélébile, avec quelques incursions vers le XIVe siècle de Jacopone da Todi et son « alta nichilitate ». Autres fréquentations : l’inaccessible Leopardi du Zibaldone ; Verga des nouvelles siciliennes, figé dans le saisissement face à la révélation d’une langue à tel point inhérente au récit qu’elle ne semble pas lui appartenir. Mais la primauté revient au XXe siècle : Pirandello, Tozzi, les poètes hermétiques des différentes générations (notamment Ungaretti et le premier Luzi), puis encore – pour rester en territoire sicilien – Lampedusa, Sciascia, Maria Attanasio, Scandurra, Burgaretta, Cannizzo : j’ai écrit sur presque tous ces auteurs ou traduit leurs écrits en castillan. Mais je suis surtout fier de deux « longues fidélités » (comme le disait le maître Gianfranco Contini à propos de Montale) : Pier Paolo Pasolini et Vincenzo Consolo. Nous reviendrons plus tard sur Pasolini. J’ai traduit et édité (en espagnol et en italien) cinq œuvres de Consolo : de son premier roman à son dernier recueil d’essais, de ses écrits hodéporiques à ses interventions sur l’art et les artistes. Ces dernières années, j’ai pris contact avec le groupe véronais Anterem, dans le cadre d’une relation qui se densifie progressivement. Avec eux, à leurs côtés, je trouve, nous trouvons, une écoute et un écho.
Les traductions de livres italiens en espagnol sont en constante augmentation. En tant que spécialiste, quel est votre avis sur la situation du livre italien traduit dans le monde hispanophone
Peut-être qu’un éditeur, ou un libraire, un spécialiste des marchés, un sociologue de la littérature, serait en mesure de répondre de manière adéquate à cette question, certainement mieux que moi : notamment parce que, pour ceux que nous appellerons opérateurs économiques ou analystes culturels, la littérature (ce que certains d’entre eux entendent par littérature) est simplement un produit à consommer. Et comme tout produit manufacturé, par exemple un produit laitier, ou comme tout équipement à obsolescence programmée, elle a une date de péremption. Je veux dire : quels sont les livres, italiens ou non, qui connaissent une croissance continue sur le marché ? Ne serait-il pas opportun de faire la distinction entre œuvre littéraire et produit éditorial, d’établir cette distinction ? Il est vrai que la présence du livre italien en Espagne est en augmentation, mais je me demande si c’est aussi le cas de la littérature italienne. Les best-sellers ne manquent pas, et il n’est même pas nécessaire de les citer. Il est également vrai que de nouvelles et excellentes traductions de Dante, de l’Ariosto et du Tasso ont récemment été proposées. Une réflexion s’impose : celle qui fait la différence entre le « jugement de représentativité » et le « jugement de valeur » : nous ne devrions pas nous occuper de décrire ce qui existe – en acceptant son éventuelle futilité comme un fait, ou, pire encore, sans même nous en rendre compte – mais ce qui mérite d’être analysé, étudié, recommandé, promu. À cet égard, et en ce qui me concerne, je dois dire que je recherche depuis des années un éditeur pour la traduction de Horcynus Orca, le grand roman de Stefano D’Arrigo – que George Steiner, le dernier des grands humanistes, comptait parmi les très rares chefs-d’œuvre de la littérature du XXe siècle tout court, et pas seulement italienne – et je n’en trouve pas.
Enfin, une dernière question s’impose sur votre plus récente « exploit » (le terme est vraiment approprié !) en tant que traducteur : l’édition en espagnol de Petrolio, l’opus magnum posthume de Pier Paolo Pasolini.
J’ai lu Petrolio lorsque le roman venait de paraître, à la fin de l’année 1992, offert à Séville par un ami proche de Pasolini, le peintre Giuseppe Zigaina : avec lui, nous préparions la première espagnole de la tragédie Orgia. Quelques années auparavant, j’avais traduit Ragazzi di vita, dans une version que j’ai ensuite révisée, au point de la republier dans une édition révisée dès les années 2000 ; entre-temps, j’avais également traduit quelques essais et quelques petits recueils de poésie. Plus récente est la traduction de Una vita violenta, que l’éditeur m’a proposée en même temps qu’une nouvelle version de Petrolio (le roman avait déjà été traduit en espagnol dans les années 90). Avant d’accepter cette mission, j’ai longuement hésité, et lorsque j’ai finalement accepté, j’ai demandé à la maison d’édition plus de temps que celui qui m’avait été initialement accordé pour la remise du travail. Ce n’était pas seulement l’ampleur du roman, sa complexité – non pas tant stylistique que conceptuelle, rythmique, respiratoire, voire parfois haletante – qui exigeait de l’aborder sans aucune urgence : c’était aussi le souvenir de cette première lecture en 1992 : ce texte m’avait, en effet, déconcerté. Et j’avais eu besoin de laisser passer plusieurs mois avant de reprendre Pasolini. Dans son testament humain, intellectuel et artistique, c’est-à-dire dans Petrolio (œuvre fragmentaire et en même temps totalisante, programmatiquement et ontologiquement inachevée, au-delà des marques formelles de l’inachèvement concret, donc idéalement in-finie), l’auteur avait poussé à l’extrême une sorte de reniement de l’art et de la vie : le narrateur place le lecteur (et un traducteur, comme le souhaitait Calvino, n’est qu’un lecteur privilégié) face à une aporie, à plusieurs apories : littéralement et étymologiquement face à des passages impraticables. La lecture ardue devient un exercice d’auto-analyse, un examen de conscience ; un examen de conscience qui, en ce qui me concerne, est devenu à la fois éthique et esthétique : Pasolini remet en question la vie et la forme, ou plutôt, il y met un terme, à la manière d’une pierre tombale. C’est en cela que consiste la tension non négligeable à laquelle il faut se soumettre pour traduire Petrolio : entrer dans l’œuvre, dans le texte comme un engin expressif ; le démonter, démonter son articulation verbale du sens, en prenant soin de ne pas le faire exploser entre ses mains ; le remonter, le réorganiser en vue d’une future explosion calculée possible.
Je dois dire, pour conclure, que je suis reconnaissant à l’éditeur Diego Moreno, de la maison madrilène Nórdica Libros, de m’avoir confié la traduction de ces trois romans, Ragazzi di vita, Una vita violenta et Petrolio, alors qu’il existait déjà des versions précédentes en castillan. Et à Giuseppe Zigaina, qui m’a mis devant le miroir : c’est à sa mémoire que je dédie le Petrolio espagnol.