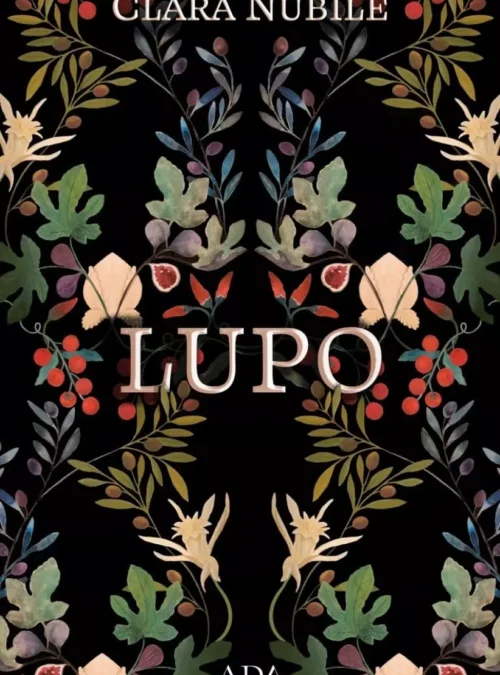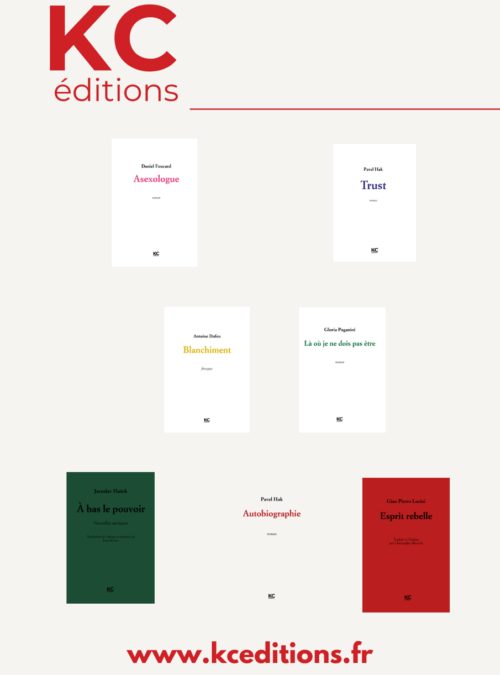Traduction et intelligence artificielle : entretien avec Paolo Bellomo
Auteur: Federica Malinverno
 ®Dimitri Bouchon-Borie
®Dimitri Bouchon-Borie
Paolo Bellomo est libraire et a grandi à Bari, dans le sud de l’Italie, en jonglant entre l’italien de cette ville et une constellation de dialectes. Il vit à Paris et évolue en français depuis bientôt quinze ans. Sa thèse de doctorat en littérature comparée portait sur “La traduction à l’épreuve de l’imitation. Traduction, pastiche, pensées de la ressemblance en France et en Italie aux XIXe et XXe siècles”. Il aime traduire des romans, du théâtre et de la poésie vers l’italien ou le français, le plus souvent à quatre mains ou plus, qu’il emprunte à une série de complices régulier·es et consentant·es. La pièce Con la carabina de Pauline Peyrade, traduite par ses soins, a reçu deux Prix Ubu en Italie en 2022. Depuis 2021, il est membre de l’Outranspo (Ouvroir de Translation Potencial). En 2024, il a publié son premier roman Faïel & les histoires du monde, aux éditions Le Tripode.
Vous êtes titulaire d’un doctorat en littérature comparée : est-ce au cours de votre parcours universitaire que vous avez commencé à vous intéresser à la traduction ?
Lorsque j’ai entamé cette dernière phase de mon parcours universitaire, j’étais déjà traducteur. Le doctorat est né de mon désir de comprendre le domaine dans lequel j’évoluais. Dans ma thèse, j’ai donc effectué un travail d’archéologie de la pensée traductive, en France et en Italie, d’un point de vue foucaldien, en essayant de lire dans les différents discours sur la traduction l’impensé du discours traductif. Je m’intéressais également aux points communs entre la traduction et l’imitation.
Cette pratique de la traduction, antérieure et contemporaine au doctorat, avait-elle déjà donné lieu à des publications ?
J’ai toujours su que je voulais être traducteur, mais lorsque j’ai commencé mon doctorat, je n’avais pas encore beaucoup publié. Cependant, du point de vue de l’expérience de la traduction, j’avais participé à ce formidable foyer qu’était le collectif de traduction théâtrale « La Langue du bourricot », que j’ai cofondé avec la professeure Céline Frigau-Manning et d’autres au sein de l’Université Paris 8. Avec des étudiants, des traducteurs, des metteurs en scène, des comédiens, des techniciens de théâtre, en nous imposant la règle de l’unanimité, nous avons traduit Duetto d’Antonio Moresco, ainsi que des textes de Matteo Bacchini ou d’Emma Dante.
Que signifie pour vous être traducteur littéraire de l’italien vers le français ? Votre formation universitaire vous a-t-elle permis de développer une approche particulière ?
Les réactions des éditeurs à l’égard de ce profil sont variables. Certains apprécient un parcours universitaire aussi long ainsi que le prestige qu’apporte le titre de docteur ; d’autres craignent que les universitaires traduisent de manière trop scolaire. De plus, le doctorat m’a donné une certaine assurance et m’a aidé à situer mon travail dans les différents courants de la traduction et à défendre mes choix de traduction avec une meilleure connaissance du sujet.
Quelle est votre position dans le débat sur le développement de l’intelligence artificielle et les changements dans le travail de traducteur ?
Pour moi, l’un des principaux intérêts de la traduction réside précisément dans l’expérience de la traduction. Entrer dans la trame d’un texte rédigé dans une autre langue, essayer d’en identifier les nœuds, comprendre comment les tirer, comment les défaire, comment les rendre plus lâches pour ensuite les renouer dans la langue cible, est l’une des choses les plus belles qui soient. C’est une activité où on ne cesse jamais d’apprendre. Lorsque vous le faites collectivement, le plaisir de cette expérience est doublé, même si les revenus sont divisés par deux. C’est comme lorsque vous travaillez au théâtre, vous créez une sorte de langage collectif, une sorte de « délire » sur le texte qui vous fait exister dans la langue d’une manière qui, jusqu’alors, vous était inconnue. Et le texte vous habite, il pénètre votre chair encore plus qu’il ne pénètre celle du lecteur. Nous, traducteurs, sommes donc des lecteurs très privilégiés. D’un point de vue pratique, si les éditeurs commencent à s’appuyer sur l’IA, non seulement ils privent les traducteurs de l’expérience dont j’ai parlé, mais ils se privent également de la qualité du travail du traducteur. S’ils confient ensuite à un bon traducteur la révision d’un texte traduit par l’IA, au final, le gain de temps est minime, le travail est plus aliénant et le résultat est tout de même moins bon qu’un texte traduit uniquement par un être humain. La plupart du temps, lorsque l’IA ne parvient pas à résoudre un problème, elle produit un texte qui semble cohérent, mais qui nécessite beaucoup plus d’attention et crée des biais, c’est-à-dire qu’elle oriente la traduction dans une direction très normative. La littérature, en revanche, va au-delà, parfois à l’encontre de la norme linguistique. Ainsi, un bon traducteur se retrouve essentiellement à défaire le travail de l’IA.
L’impact actuel et potentiel de l’IA sur le monde de la traduction vous préoccupe-t-il ?
À mon avis, les traducteurs et les éditeurs devront se réunir et discuter de ces questions afin d’éviter que la présence et la facilité de l’IA ne pèsent sur le rapport de force salarial du travail du traducteur. Car ce serait le début de la fin. Je ne crains pas tant que l’intelligence artificielle parvienne à traduire comme les êtres humains, car je n’y crois pas. Je crains plutôt que l’on finisse par se contenter de quelque chose de « pas si mal ». Et cela représente pour moi la fin de la littérature et du métier, non seulement de traducteur, mais aussi d’éditeur. Car il pourrait arriver que ce savoir-faire consistant à élaborer des lignes éditoriales – qui, pour l’instant, est encore l’apanage des êtres humains, éditeurs et traducteurs… – soit, à un moment donné, délégué à l’IA par les directeurs financiers des maisons d’édition. Donc, si c’est mon métier qui est en danger aujourd’hui, cela signifie que les autres le seront aussi, car tout est interconnecté. Et c’est donc d’autant plus important de se réunir et de défendre ces professions.
Pour en revenir à votre métier de traducteur, parvenez-vous toujours à traduire des textes qui vous intéressent et que vous appréciez ? Si oui, comment procédez-vous ?
Étant donné que, depuis que j’ai commencé ce métier, j’ai toujours exercé d’autres activités, j’ai été « très privilégié » : jusqu’à présent, j’ai pratiquement traduit presque uniquement des livres que j’appréciais. Sur le marché franco-italien, les agents littéraires sont très actifs : ma valeur ajoutée consiste alors à rechercher des titres qui sont passés inaperçus dans le contexte éditorial, non pas italien mais international, par exemple lors des salons du livre à Francfort. Mon activité de libraire me donne également une lecture et une visibilité sur les lignes éditoriales des maisons d’édition françaises. À titre d’exemple, l’année dernière, j’ai lu Inventario di quel che resta dopo che la foresta bruci de Michele Ruol [TerraRossa edizioni, 2024], que j’ai trouvé non seulement excellent, mais également adapté au marché français, et je l’ai proposé à Le Tripode. Ils m’ont fait confiance et l’ont acheté plusieurs mois avant qu’il ne soit finaliste du prix Strega.
Sur quels critères vous basez-vous pour choisir les livres italiens que vous proposez en France ?
Depuis que je suis libraire, je suis un lecteur très éclectique, mes goûts se sont beaucoup élargis. Cependant, lorsque je lis un texte, ce qu’on appelle une « alchimie » peut se produire ou ne pas se produire du tout. Je m’explique : un texte peut me plaire en tant que lecteur, mais il ne déclenche pas nécessairement en moi ce que Berman appelle la pulsion traductive, c’est-à-dire l’envie, le besoin existentiel de le traduire. Il y a aussi des livres pour lesquels l’expérience de la traduction peut être moins enthousiasmante, mais qui me donnent du travail. Donc, je ne me borne pas à faire confiance à mon flair uniquement pour les livres qui déclenchent cette pulsion.
Pouvez-vous nous parler de votre expérience de l’autotraduction ? Qu’est-ce que cela a signifié pour vous ?
L’autotraduction [c’est-à-dire la traduction de Faïel et les histoires du monde, Le Tripode, 2024, NDR] n’était pas nécessairement une expérience que je souhaitais vivre. C’est à l’invitation de Fandango [l’éditeur italien, NDR] que je me suis posé la question : « Pourquoi pas ? » Je me suis dit : « Traduis-toi comme s’il s’agissait du texte d’un autre, c’est-à-dire garde la même distance par rapport à ton texte ». Cependant, dans ce cas précis, le texte m’était si peu inconnu que je ne parvenais pas à vivre l’expérience de la distance, et j’avais l’impression que le texte final était une sorte de texte en papier mâché, qui bougeait par à-coups peu crédibles. J’ai dû me mettre dans une sorte d’état de transe, ce que je ne fais généralement pas lorsque je traduis. C’était très étrange, mais je ne dirais pas qu’il s’agit d’une réécriture, pour moi cela reste une traduction : j’ai très peu réécrit et surtout des phrases qui ne me convenaient pas au niveau du rythme. De plus, cela faisait très longtemps que je n’avais pas écrit en italien, et avec un tel niveau d’exigence poétique. J’ai enfin eu l’impression de retrouver une vieille amie, ma langue, et c’était magnifique.
L’autre pratique de traduction que vous avez souvent expérimentée est celle de la traduction à quatre mains. De quel type d’expérience s’agit-il ?
Si ce n’était pas aussi difficile financièrement, je ne ferais que cela, surtout en raison de la question du « délire » autour du texte dont j’ai parlé précédemment. De plus, la traduction à quatre mains renforce le texte, car elle vous permet de vous voir dans un miroir et de mieux prendre conscience de vos choix de traduction. Et surtout, elle vous permet de faire évoluer et de redimensionner vos tabous linguistiques, de comprendre que votre maîtrise de la langue est relative.
Pensez-vous que la France accorde aujourd’hui une attention particulière à la littérature italienne contemporaine ?
Cela dépend de l’éditeur, mais je pense qu’il y a beaucoup d’attention. Par exemple, il est très difficile de trouver un repêchage qui n’ait pas déjà été évalué par les éditeurs français auxquels on s’adresse. Pour moi, nous, traducteurs, agents, scouts, avons pour mission d’essayer de mettre en lumière des auteurs qui n’ont pas encore été « vus » par le marché, mais qui le méritent. Au-delà des impératifs économiques, il existe en effet des éditeurs qui font des choix audacieux. Nous avons évoqué précédemment Ruol, qui s’est vendu à environ 15 000 exemplaires, mais qui, lorsque je l’ai proposé, s’était vendu à environ 1 000 exemplaires. La recherche de stéréotypes, en revanche, me semble se limiter aux couvertures des livres. J’ai vu des livres écrits par des auteurs du sud de l’Italie qui n’étaient pas situés en bord de mer et dont la couverture représentait une plage. Je pense toutefois qu’il s’agit davantage d’une forme de marketing que d’une recherche active de textes véhiculant des stéréotypes.
Pour conclure, une question sur le passé et une sur l’avenir : pouvez-vous nous parler des livres italiens que vous avez traduits et de ce qu’ils vous ont apporté ? Et quel est le livre que vous aimeriez traduire ?
Parmi les livres du passé, il y a Alessandro Robecchi, la série mettant en scène Carlo Monterossi [éditions Sellerio; en France, Éditions de l’Aube]. Pour moi, cela a été une formidable source d’inspiration pour travailler la technique de l’humour. Je l’ai traduit avec Agathe Lauriot dit Prevost, qui possède cette sensibilité. La traduction de Robecchi m’a permis d’acquérir une plus grande assurance dans la traduction de l’humour. C’est une direction que j’aimerais continuer à explorer. L’expérience de traduction la plus incroyable a été les deux volumes de Fifty Fifty. Warum e le avventure conerotiche et Saint’Aram nel Regno di Marte d’Ezio Sinigaglia [TerraRossa edizioni, 2021], traduits en français sous le titre Les aventures érotiques de Warum & Saint Aram pour les éditions Emmanuelle Collas [2025] en collaboration avec Cécile Raulet, car je considère Sinigaglia comme l’un des meilleurs écrivains italiens contemporains. C’est un écrivain du XXe siècle que nous publions au XXIe siècle, car pendant des années, il n’a pas souhaité être publié. Sinigaglia travaille la langue d’une manière si ludique, irrévérencieuse et fine, qu’il fait exploser le langage, qu’il le réinvente. Il travaille tellement dans ce que Barthes appellerait le « feuilleté du langage », cette intra-langue, cette verve, que le traduire vous oblige à reproduire ce travail qui, d’ailleurs, est le même que celui vers lequel tendent mes névroses. Quant à l’avenir, il y a un livre que j’aime beaucoup et que je trouve extraordinaire que quelqu’un en Italie ait eu le courage de publier, un livre extrêmement anachronique : Lo splendore de Pier Paolo di Mino [Laurana, 2024]. Plus de 700 pages, pour le premier volume sur sept, ce qui représente un défi considérable pour un éditeur étranger. Une fresque européenne qui revient sur la question du salut de l’humanité, du bien et du mal. C’est l’œuvre d’un mystique, qui a un rythme envoûtant et un goût très prononcé pour le romanesque. Un texte qui a besoin d’être soutenu, défendu avec acharnement par l’éditeur qui le choisira, mais qui, à mon avis, est l’une des œuvres les plus intéressantes publiées en Italie ces dernières années, une œuvre qui pourrait devenir un classique de la littérature italienne. Enfin, un autre titre que j’aimerais beaucoup traduire est Popoff de Graziano Gala [2024, minimum fax], un roman pour adultes qui joue avec les codes de la comptine pour enfants et qui fait naître des images d’une grande force poétique et évocatrice, une petite pépite importante, deuxième œuvre d’un auteur qui fera son chemin.