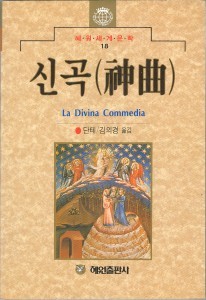La Divine Comédie en traduction – Seconde partie
Auteur: Mirko Tavoni, University of Pisa
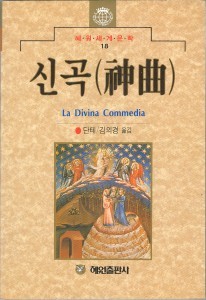
Au cours des soixante premières années du XXe siècle, des traductions versifiées (alexandrins, vers déca ou dodécasyllabiques, vers libres), diversement rimées et non rimées, ont été publiées par des traducteurs de différentes formations : philosophes ou théologiens (Amédée de Margerie, 1900 ; Joachim Berthier, 1921), italianistes (Henri Hauvette, 1921 ; Pierre Ronzy, 1960), musicologues et historiens de l’art (Adolphe Meliot, 1908 ; Joseph André Pératé, 1922-1924), des archivistes (Henri Longnon, 1931), des poètes et écrivains (Louise Espinasse-Mongenet, 1912 ; René-Albert Gutmann, 1928 ; Martin-Saint-René ou Gustave Lucien René Martin, 1935 ; André Doderet, 1938 ; Alexandre Masseron, 1947-1950). Mais les deux traductions françaises les plus importantes demeurent celle (publiée l’année du centenaire, en 1965) de l’italianiste du Collège de France André Pézard (traducteur et commentateur des œuvres complètes de Dante dans la Pléiade), et celle de la poétesse, critique militante et italianiste Jacqueline Risset (1985-1990). La traduction d’André Pézard, en décasyllabes non rimés, se caractérise par l’utilisation systématique d’archaïsmes et de termes dialectaux visant à reproduire le multilinguisme du texte de Dante. En accord avec « l’idée de Dante » de Gianfranco Contini, Pézard problématise, avec un esprit philologico-critique, le sens exact et la connotation de chaque expression à traduire et vise à produire un texte qui fasse vivre au lecteur français une expérience comparable à celle du lecteur italien face au texte de Dante. Il s’agit de lui faire percevoir la distance linguistique qui le sépare du texte (bien que la distance de l’italien moderne à l’italien ancien soit, comme on le sait, bien moindre que la distance entre le français moderne et l’ancien français). On a reproché à cette proposition d’évoquer davantage un Moyen Âge français qu’un Moyen Âge italien, et de “spécialiser” la lecture de Dante en l’éloignant du grand public. On ne peut toutefois que souscrire à l’observation de Jacqueline Risset selon laquelle la langue de Dante n’était certainement pas tournée vers le passé mais vers l’avenir. Liée à la revue d’avant-garde Tel Quel, Risset tendait résolument vers une traduction littérale, claire et moderne, allant jusqu’à sacrifier la régularité métrique à l’immédiateté du sens, favorisant ainsi non seulement la lisibilité, ce qui a certainement permis d’élargir le lectorat en France, mais aussi l’effet typiquement dantesque de la rapidité de la dictée.
Réagissant presque à ce que Risset a appelé elle-même « l’absence » de Dante dans la littérature française – dans le sens de l’altérité de Dante par rapport à son empreinte “classiciste” de longue date – les trente dernières années ont vu fleurir des traductions qui continuent d’expérimenter une variété de solutions métriques, du vers libre polymétrique (Lucienne Portier, 1987 ; le musicien Marc Didier Garin, 2003), aux tercets polymétriques (le Serbe de Bosnie Kolja Mićević, 1998), aux décasyllabes non rimés (Marc Scialom, 1996), en passant par l’alternance de décasyllabes et de dodécasyllabes (le poète Jean-Charles Vegliante, 1996-2007), les triplés de décasyllabes (Danièle Robert, 2016), ou d’étranges octosyllabes (René de Ceccatty, 2017).
La première traduction espagnole du XIXe siècle, en tercets hendécasyllabes (1868), est due à Juan Manuel de la Pezuela y de Ceballos, aristocrate, homme de lettres, homme politique et soldat. Elle est suivie par la traduction en prose de l’ingénieur Manuel Aranda y Sanjuán (1871). Juan de la Pezuela, fils du vice-roi du Pérou et lui-même né à Lima, a occupé des postes au gouvernement colonial à Porto Rico et à Cuba, et sa traduction a été la première à faire connaître Dante en Amérique latine. Président pendant trente ans de la Real Academia de la Lengua, son intérêt pour Dante était purement littéraire. Tout autre était la motivation qui a poussé Bartolomé Mitre, homme d’État, journaliste et homme de lettres argentin, président de la République argentine de 1862 à 1868, à réaliser sa traduction en tercets, publiée entre 1893 et 1897, dans l’espagnol parlé dans le Rio de la Plata. Ce projet, préparé par la tradition humaniste inaugurée par Andrés Bello, professeur de Simón Bolívar, par la tradition de lecture des poèmes nationaux initiée par Esteban Echeverría, poète mazzinien et homme politique romantique, et par le poème épique national Martín Fierro, apparaissait à Mitre comme un véritable « acte de gouvernement », qui permettait de démontrer au monde la modernité et la maturité historique de l’Argentine. Ce pays se mettait ainsi sur un pied d’égalité avec les États-Unis, qui avaient traduit la Divine Comédie (Longfellow en 1867), et rendait en même temps hommage à l’Italie, qui venait d’achever son unité politique. Le nom et le mythe de Dante en Amérique latine, particulièrement en Argentine, étaient en effet, et restent jusqu’à aujourd’hui liés aux imposantes immigrations en provenance d’Italie. Le Sommo Poeta représentait à la fois la nostalgie et la fierté de la lointaine patrie. Il était célébré par la lecture des Canti dans les théâtres étant ainsi à la portée de ceux qui ne savaient pas lire. Il était célébré aussi par des statues érigées dans les villes argentines tout comme dans les villes italiennes, donnant lieu à certaines prouesses comme le Palacio Barolo de Buenos Aires, qui reproduit sur 100 mètres de hauteur (un mètre pour chaque chant) la cosmologie de la Divine Comédie.
Parmi les traductions du XXe siècle et au-delà, citons celles, réalisées en Espagne, d’Arturo Cuyás de la Vega (1965, prose), Antonio J. Onieva (1965, vers libres), Ángel Crespo (1973-1977, vers libres), Nicolás González Ruiz (1973, terza rima), Luis Martinez de Merlo (1988, hendécasyllabes libres) ; et celles, produites en Argentine, d’Enrique Martorelli Francia (1967, tercets hendécasyllabiques), Ángel J. Battistessa (1968), Antonio Jorge Milano (2002) et Claudia Fernández Speier (2021).
Les premières traductions en portugais ont été réalisées au cours des mêmes années au Portugal et au Brésil : au Portugal, celle en prose de Joaquim Pinto de Campos (1886) et celle en “terza rima” de Domingo José Ennes (1887-18889) ; au Brésil, celle en hendécasyllabes libres de Francisco Bonifácio de Abreu (1888) et celle en tercets de José Pedro Pinheiro (1888-1907). Et tout au long du XXe siècle et au-delà, les traductions brésiliennes – João Ziller (1953), Haroldo de Campos (1976), Cristiano Martins (1976-1979), Hernani Donato (1981), Eugenio Mauro (1998), Jorge Wanderley (2004) – ont dépassé les traductions portugaises de Marques Braga (1955-1958) et Vasco Graça Moura (1995).
La première traduction catalane moderne, celle de Narcís Verdaguer i Callís, a été publiée à l’occasion du centenaire en 1921, suivie en 1923 par celle de Llorenç de Balanzó. La plus connue, celle de Josep Maria de Sagarra, en décasyllabes rimés, a commencé à être publié en série en 1935 dans le Veu de Catalunya, mais a été interrompue au début de la guerre civile et n’a pu être achevée et publié qu’en 1947-1951, après avoir laborieusement obtenu l’autorisation du gouvernement franquiste. Elle a été suivie en 2001 par celle de Joan F. Mira, en décasyllabes non rimés.
La première traduction en roumain (1860), en prose archaïque, est due à l’intellectuel et homme politique Ion Heliade Rădulescu, promoteur d’une modernisation-standardisation de la langue roumaine ouverte à l’influence de l’italien. Les deux traductions fondamentales sont celle du poète et écrivain George Coșbuc, publiée à titre posthume en 1925, et celle du poète et écrivain Eta Boeriu (1965), toutes deux en tercets.
Une traduction en occitan, en prose, a été réalisée en 1967 par le provençaliste Jean Roche, et une en galicien, en tercets, par l’écrivain et homme politique galicien Darío Xohán Cabana en 1990. La première traduction de la Divine Comédie en sarde logudorese est due au prêtre Pedru Casu et remonte à 1929. Elle est suivie de la traduction de l’Enfer par le prêtre Paolo Monni en 2000, toutes deux en tercets hendécasyllabiques. Les traductions en frioulan sont récentes, tout comme la revendication active du statut de langue : après celle, incomplète, en vers libres de Domenico Zannier, également prêtre, en 1997, celles de l’Enfer en tercets d’Ermes Culòs, Frioulan émigré au Canada (publiée en ligne, 2006) et de Pierluigi Visintin (2011), et celle, complète, également en tercets, d’Aurelio Venuti (2015). Les traductions en dialectes italiens sont au nombre de près de quarante, également réparties entre les dialectes du nord, du centre et du sud, du début du XIXe siècle à nos jours. On ne peut manquer de rappeler avec la déférence qui lui est dû, le pastiche en octaves milanaises des premiers chants de l’Enfer réalisé par Carlo Porta à partir de 1804, dans le sillage de la traduction de la Jérusalem délivrée de Torquato Tasso par le plus grand poète dialectal milanais du XVIIIe siècle, Domenico Balestrieri.
Les langues germaniques ont produit leurs propres traductions à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. L’Enfer est traduit en néerlandais en tercets par le poète Jan Jakob Lodewijk ten Kate en 1876 ; le poème entier par le poète Jacques Charles Rensburg en 1906-1908, par le poète Albert Verwey en 1923, par le religieux Christinus Kops en 1930, par Betsy van Oyen-Zeeman, une illustre inconnue, en 1932 (la traduction de Kops en hendécasyllabes libres, les autres en tercets). En danois, nous disposons des traductions de la Divine Comédie par le poète et critique Christian Knud Frederik Molbech, en tercets (1851-1863) et par l’érudit Ole Meyer, en hendécasyllabes (2000) ; en suédois, des traductions de la Divine Comédie par le pasteur Nils Lovén (1856-1857), la poétesse Aline Pipping (1915), le scientifique Arnold Norlind (1921) et le poète Ingvar Björkeson (1983), ce dernier en hendécasyllabes libres, le premier en tercets. Il faut attendre 1965 pour la première traduction en norvégien, en tercets, des poètes Henryk Rytter et Sigmund Skard ; 1993 pour celle, en hendécasyllabes libres, du philologue Magnus Ulleland ; 1968 pour la traduction islandaise de 12 chants de la Comédie, en tercets, par le poète Guðmundur Böðvarsson ; 2010 pour la traduction complète en prose par l’érudit Erlingur E. Halldórsson.
En 1963, le mathématicien et prêtre irlandais Pádraig de Brún (également connu sous le nom de Patrick Joseph Browne) a publié une traduction gaélique de l’Enfer en vers libres.
En allant vers l’est de l’Europe, la première traduction grecque est celle de l’Enfer par le Céphallénien Panaghiotis Vergotìs ; la seconde est celle de la Divine Comédie en langue grecque katharèvousa (la forme littéraire précieuse de la langue grecque), en dodécasyllabes plats (avec l’accent sur l’avant-dernière syllabe du vers), par Konstantinos Mousouros Pacha (1882-1883), qui, comme son nom l’indique, est un sujet, ainsi qu’un diplomate, de l’Empire ottoman. Elle fut suivie de la traduction de l’Enfer par Geōrgios Kalosgouros (1905), mais la traduction la plus précieuse fut celle de l’intégralité de la Divine Comédie, en dimotikì (la forme plus populaire de la langue grecque), en hendécasyllabes libres, par le poète Nikos Kazantzakis, un intellectuel formé en Europe. Publié en 1934, puis profondément modifié en fonction de l’élaboration de son propre poème L’Odyssée, et publié dans une édition définitive en 1954-1955, il fait preuve d’une grande force expressionniste dans son rendu de la langue de Dante.
Le domaine slave s’étend de l’Adriatique à l’Oural. Toutefois, il y a une différence historico-culturelle fondamentale entre les langues appartenant au slave romain, c’est-à-dire catholique, avec le latin comme langue de culture et utilisation de l’alphabet latin (slovène, croate, tchèque, slovaque, polonais), et les langues appartenant au domaine slave orthodoxe, avec le slavon grec/ecclésiastique comme langue de culture et l’utilisation de l’alphabet cyrillique (serbe, macédonien, bulgare, russe, ukrainien). On observe une prédominance des traductions de la Divine Comédie dans le domaine slave romain. Il fallait s’y attendre étant entendu l’affinité du monde slave romain avec celui de Dante. On remarque des traductions en slovène et en croate qui sont les langues de la Dalmatie liée à Venise depuis des siècles – après tout, l’humaniste croate Marko Marulić, alias Marcus Marulus Spalatensis, avait traduit le premier chant de l’Enfer en latin en 1480, tout comme ses collègues italiens Giovanni Bertoldi da Serravalle et Matteo Ronto. Et il y a une forte présence du polonais, signe d’une culture particulièrement italophile. Mais aux XIXe et XXe siècles, à partir du romantisme, on assiste à une véritable circulation européenne de Dante qui – de manière moins intense toutefois – pénètre également en Serbie, en Macédoine, en Ukraine, en Bulgarie et surtout en Russie.
En effet, la plus ancienne traduction est russe : le médecin Dmitry Egorovič Min a traduit l’Enfer en 1855, en tercets, puis a mis trente ans, jusqu’à sa mort en 1885, pour traduire les deux autres chants. L’édition complète est parue à titre posthume en 1907, après avoir surmonté les problèmes de la censure tsariste. Elle reçoit le prix Pouchkine de l’Académie des sciences. Un peu plus tard, la première traduction polonaise, en couplets et rimes alternés, du poète romantique Julian Korsak, publiée à titre posthume en 1860, suivie en 1864-1865 de la traduction inédite de l’écrivain et romancier, Józef Ignacy Kraszewski, et en 1870 de la traduction en hendécasyllabes libres du juriste et poète Antoni Robert Stanisławski. En 1878-1882, paraissait la traduction du poète bohémien Jaroslav Vrchlický, destinée à démontrer la valeur de la langue tchèque – objectif commun à de nombreuses tentatives de traductions dans des pays sans grande littérature, toujours mis en avant dans une perspective militante, comme dans les cas de tentatives de traductions dans des langues minoritaires. Ainsi, dans tout le vaste domaine slave, au XIXe siècle, il n’existe que cinq traductions de la Divine Comédie, et trois d’entre elles sont en polonais.
Au cours du XXe siècle, en partant de la côte adriatique, nous trouvons des traductions en slovène, intégrales et en tercets, du théologien Jože Debevec (1910-1914), du critique littéraire et poète Tine Debeljak (1960) et de l’écrivain et homme politique Andrej Capuder (1972), ainsi que la traduction de l’Enfer et du Purgatoire par le poète Alojz Gradnik (1959-1965). En croate, traductions du peintre et homme politique Isidor Kršnjavi (intégrale, 1909-1915), du poète et homme politique Vlamidir Nazor (Enfer, 1943), et de l’homme de lettres Mihovil Kombol (traduction intégrale en tercets, 1948-1960, complétée pour la dernière partie du Paradis par Olinko Delorko). En tchèque, la traduction en tercets de la Divine Comédie par le polyglotte Otto František Babler (1952), assisté du poète Jan Zahradníček, non accréditée car son auteur était persécuté par le régime communiste ; et de l’Enfer seul par le spécialiste de la philosophie antique Vladimir Mikeš (1978). En slovaque, la traduction de la Divine Comédie par le savant Jozef Felix et le poète Viliam Turčány (1958-1982), et de l’Enfer seul par le savant Karol Strmen (1965). Les résultats obtenus par les Polonais sont remarquables. Outre les trois traductions du XIXe siècle déjà mentionnées, il existe quatre traductions du XXe siècle, toutes complètes : celle, inédite, de S. R. Dembiński (1902) ; celle dite « canonique », en tercets, du romaniste et poète Edward Porębowicz (1925) ; et celles de J. Michał Kowalski (1932) et d’Alina Świderska (1947). Et, comme le témoignage d’un intérêt continu, deux autres traductions ont été publiées ces dernières années par Agnieszka Kuciak (2006) et Jaroslaw Mikołajewski (2021).
En ce qui concerne le monde slave orthodoxe, nous avons, pour le Serbe, Dragisa Stanojevic (intégrale, 1928) ; pour le Macédonien, Georgi Stalev (intégrale, 1967) ; pour le Bulgare, Konstantin Veličkov (Enfer, 1906), Kiril Christov (Enfer, 1935) et Ljuben Ljubenov (intégrale, 1975). En 1902, paraît la traduction russe complète de Nikolaï Golovanov, qui reste l’édition de référence jusqu’à ce que, à l’époque soviétique, elle soit remplacée par celle de l’ancien poète acméiste Michail Leonidovič Lozinskij (prix Staline 1946). Préparée par des recherches historiques approfondies, des contacts étendus et systématiques avec des universitaires de diverses disciplines et des réflexions approfondies sur le potentiel de la langue russe, et réalisée pour l’essentiel dans les conditions héroïques du siège de Leningrad, elle est jugée d’une qualité conceptuelle et stylistique remarquable. Elle a été réimprimée en 1968 dans l’édition complète des œuvres de Dante et est restée la seule en usage pendant des décennies. Elle a été suivie en succession rapide par deux traductions conçues dans les années de la perestroïka : celle en hendécasyllabes libres du poète et érudit Aleksandr Anatolevic Iljušin (1995), qui adopte une variété de registres, un mélange d’archaïsmes, de néologismes et de slavon ecclésiastique, hors de portée du lecteur commun ; celle du sculpteur, peintre et acteur Vladimir Lemport (1996-97), qui la dote d’un appareil figuratif produit par lui-même et vise une lisibilité plus directe ; et celle de Vladimir Marancman (1999-2006), qui se propose d’offrir au lecteur une traduction compréhensible sans perdre le sens de la distance historique. La première traduction ukrainienne est due au poète, intellectuel et homme politique socialiste et nationaliste antimarxiste et antirusse, Ivan Nikolaevic Franko (Enfer, avant 1916). Une autre traduction de l’Enfer a été réalisée en 1956 par le traducteur Petro Karmanskij en collaboration avec Maxim Rilskij, le plus grand poète ukrainien du XXe siècle ; puis la traduction complète du poème par le poète Evgen A. Drob’jazko (1968-1976), et encore une traduction de l’Enfer, en tercets, par le physicien et spécialiste de la littérature Maxim Strikha (2013).
Dans les langues baltes, nous disposons de quatre traductions de la Divine Comédie : en letton celle de Jēkabs Māsens, en tercets (1921-1937) et celle de Valdis Bisenieks (1994) ; en lituanien celles de Jurgis Narjauskas (1968-1971) et d’Aleksys Churginas (1968-1971).
En albanais, plus précisément dans la variété Ghega du nord, il existe une magistrale traduction complète en tercets publiée en 1960-1966 par le poète et prosateur Pashko Gjeçi. Sa traduction, à laquelle il a consacré 22 ans de sa vie, résume un demi-siècle de relations entre l’Italie et l’Albanie : après avoir étudié, enfant, au lycée italien de Shkodra et obtenu un diplôme de l’université de Rome pendant les années d’occupation italienne (1939-1943), Pashko Gjeçi a été condamné aux travaux forcés, puis est obligé à vivre en semi-clandestinité.
En hongrois, nous avons une traduction de la Comédie par siècle : par l’érudit et homme politique Károly Szász, en tercets (1885-1899) ; par le poète Mihály Babits, également en tercets (1913-1923) ; et par le poète Ferenc Baranyi (2012) en hendécasyllabes détachés; en finnois, traduit par le poète Eino Leino (1980); en estonien, autre langue du groupe finno-ougrien, traduction du poète Harald Rajamets (2011); en basque, traduction en prose par Aita Santi Onaindia (1985).
La première traduction de la Divine Comédie en hébreu est due à un écrivain et médecin originaire de Trieste, Saul Formiggini, qui a publié l’Enfer (Trieste, 1869). La première traduction intégrale est due au folkloriste polonais Immanuel Olsvanger, sioniste, qui a émigré en Terre d’Israël en 1933, et l’a publiée à Jérusalem en 1943. Le troisième est de Yoav Rinon, professeur à l’université hébraïque de Jérusalem, qui a publié l’Enfer à Tel Aviv en 2013. Une traduction libre de l’Enfer en yiddish a été réalisée en 1932 par le Lituanien Shmuel Kokhav-Shtern.
Étant donné les relations étroites de Malte avec l’Italie, la Divine Comédie a été traduite plusieurs fois en maltais (une variété d’arabe avec de fortes composantes lexicales siciliennes et italiennes) : l’Enfer par Giovanni Sapiano Lanzon en 1905 et par Erin Serracino Inglott en 1964, l’intégralité de la Divine Comédie, en tercets, par le grand traducteur maltais Alfred Palma en 1991.
La première traduction arabe complète de la Divine Comédie a été publiée à Tripoli, sous domination italienne, en 1930-1933, par le professeur de langue italienne Abbūd Abī Rashid’. Il s’agit d’une version très approximative, comme l’est aussi la version de l’Enfer seul, également en prose, publiée à Jérusalem en 1938 par le Palestinien Amīn Abū Sha’ar, qui s’appuie d’ailleurs largement sur la traduction anglaise de Henry Francis Cary (voir ci-dessus) plutôt que sur l’original. Les deux traductions de référence aujourd’hui sont celle en prose de l’italianiste égyptien Ḥasan ʿUthmān (1955-1969) et la traduction en vers de l’Irakien Kāzim Jihād (2002), professeur à Paris. La première, accompagnée d’une étude approfondie, vise à mettre le lecteur arabe en mesure de comprendre les fondements du texte et du monde dont il est issu, en l’éloignant de la stricte problématique des prétendues sources islamiques du voyage au-delà du monde, lancée par le philologue espagnol Miguel Asín Palacios en 1919, qui avait absorbé toute l’attention dans le monde arabe dans les années 1930. Elle présente, au contraire, un Dante à l’empreinte politico-didactique conforme à l’orientation nassérienne. La seconde traduction, en revanche, privilégie plutôt les aspects formels du langage poétique. On observe, comme on pouvait s’y attendre, que les versets sur “Muhammad le semeur de discorde” sont censurés dans les deux traductions.
En turc, nous avons la traduction de la Divine Comédie en prose par le spécialiste de Dante Feridun Timur (1955-1956), celle en vers libres par l’écrivain et juriste Rekin Teksoy (1998). En arménien occidental, les traductions du père Arsenio Ghazikian (1902) et du père Athanasius Tiroyan (1930), en arménien en tercets par le philologue Arpun Dayan (1947). En géorgien, datant de l’époque soviétique, la traduction de l’universitaire et homme politique Konstantin Gamsachurdia en collaboration avec le poète Konstantin Čičinadze (1933-1941). En persan, préparé à partir de poèmes et d’essais d’intérêt mystique pour le voyage au-delà du monde, la traduction de l’écrivain Shojaeddin Shafa (1957) et celle en vers de la poétesse Farideh Mahdavi-Damghani (2000). En kazakh, celui en tercets du poète Mukagali Makatajev (1971).
En Inde, qui faisait partie de l’Empire britannique, l’intérêt pour Dante a commencé à se répandre, dans le sillage du contexte florissant dont nous avons parlé plus haut, parmi les poètes et les universitaires dans la seconde moitié du XIXe siècle : par exemple, Dante et Milton ont influencé les œuvres du poète et dramaturge bengali Michael Madhusudan Datta (1824-1873). Mais c’est précisément l’abondance et la qualité des traductions en anglais, combinées au statut de l’anglais comme langue officielle, qui ont totalement écarté la nécessité de traduire Dante dans les langues locales, qui n’est apparue que bien après l’indépendance, au cours des toutes dernières années. La première traduction dans une langue indienne est dans une langue dravidienne, le malayalam, la langue nationale de l’État du Kerala, parlée « seulement » par 33 millions de personnes : le poète Kilimanoor Ramakantan a publié sa traduction en vers en 2001. La seconde est en bengali, langue indo-européenne, qui est, avec ses 200 millions de locuteurs, la deuxième langue nationale la plus répandue dans le pays, après l’hindi : le journaliste et romancier Shyamalkumar Gangopadhyay a publié sa traduction en tercets en 2011.
Une certaine idée de Dante, en l’absence de ses textes ainsi que des compétences nécessaires pour le comprendre vaguement, étant donné la séparation des mondes culturels respectifs, n’est arrivée en Chine qu’à la fin du XIXe siècle. Par exemple, le poète Liang Qichao lui a rendu hommage lors de son exil au Japon (1898-1912) en le faisant apparaître sur scène, dans son mélodrame La nouvelle Rome, sous des traits taoïstes, chevauchant une grue, pour réciter un monologue sur la nouvelle identité que la Chine devait assumer dans cette phase de profonde transformation. Pour le centenaire de 1921, le jeune poète Qian Daosun, qui avait séjourné en Italie des années auparavant en compagnie de son père, proposa une version métrique courageuse des trois premiers chants de l’Enfer, basée sur le travail de son collègue japonais Yamakawa Heizaburo, qui s’était à son tour appuyé sur la traduction allemande de Streckfuss et les traductions anglaises de Cary et Longfellow. En utilisant la même méthode, basée sur des traductions françaises et anglaises du XIXe siècle, Wang Weike a achevé la première traduction complète en prose de la Comédie en 1939.
L’élan de ces premières décennies – qui ne fut pas exempt de naïveté, ne disposant pas des instruments pour apprendre à connaître Dante – a coupé net par la révolution culturelle : pour le centenaire de 1965, ce fut le silence absolu. La possibilité de regarder dans cette direction s’est rouverte à la fin des années 1970, et c’est ainsi que Zhu Weiji a pu reprendre la traduction de l’Enfer qu’il avait publiée en 1954, la compléter et publier en 1984 la première traduction complète de la Comédie en vers : traduite non pas de l’italien mais des traductions anglaises de Cary, Carlyle et Longfellow.
La première version traduite de l’italien a été celle en prose de Tian Dewang, professeur à l’université de Pékin, qui l’a entreprise en 1982, à l’âge de 73 ans, après avoir pris sa retraite, et l’a achevée en 1997, ce qui lui a valu de recevoir du président Scalfaro l’Ordre du mérite de la République italienne. En 2000, c’est au tour de la traduction en vers de Huang Wenjie, et en 2003 de celle du professeur de Hongkong Huang Guobin (nom occidental Laurence K. P. Wong) : une version prosodique considérée comme d’une qualité rythmique exceptionnelle, avec des solutions de traduction extraordinaires. Puis la version du poète Zhang Shuguang (2005), qui marque toutefois une régression en s’appuyant sur des traductions anglaises ; et plus récemment celle de l’italianiste de l’université de Pékin, primé pour la traduction d’autres classiques italiens, Wang Jun (2021). Comme on peut le constater, en ce début du XXIe siècle, la Chine rattrape le temps perdu.
Dans ce contexte historique, l’existence d’une traduction complète en vers, inédite, réalisée dans les années 1910-1920 (!) par un Italien (!) apparaît d’une valeur exceptionnelle et ne manque pas de surprendre. Il s’agit de celle du Père Agostino Biagi, O.F.M. (1882-1957), missionnaire en Chine. Une fois de retour en Italie, ce prêtre se trouva en désaccord avec l’Église de Rome et devint pasteur évangélique. Antifasciste de la première heure, Agostino Biagi fut agressé pour ses idées politiques pro-communistes et placé sous surveillance par toutes les polices fascistes d’une grande partie de l’Italie. Cet homme a produit pas moins de trois versions différentes de la Divine Comédie avec trois mètres chinois différents qui attendent d’être étudiés, mais dont la qualité a impressionné les sinologues qui y ont jeté un coup d’œil à notre demande. Ces carnets, déposés à l’Accademia della Crusca, sont progressivement mis à disposition sur internet: https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-commedia-in-cinese-in-rete-il-primo-quaderno-del-fondo-biagi/24627.
La Divine Comédie avait atteint le Japon en premier. Nous avons déjà mentionné la traduction en vers de l’intégralité du poème par Yamakawa Heizaburo, professeur d’anglais à l’université de Sendai, en 1914. La première traduction de l’italien fut celle du pasteur et théologien Masaki Nakayama, en 1919 ; suivie beaucoup plus tard par celle de Soichi Nogami, italianiste aux universités de Kyoto et de Tokyo, en 1962, et celle de Sukehiro Hirakawa, expert en relations interculturelles, en 1966.
Le tableau de l’Extrême-Orient est complété par les cinq (!) traductions coréennes – I Sang-Ro (1959), Society of Thought and Culture Studies (1960), Choi Mun-Seon (1960), Chung Noh-Young (1993), Kim Wi-Gyeong (2002) – et la traduction vietnamienne de l’italianiste de l’Université de Hanoi Nguyen Van Hoan (2006).
Les traductions de la Divine Comédie en espéranto ne pouvaient manquer! Et il y en a effectivement trois : celle du Hongrois Kálmán Kalocsay (1933) et des Italiens Giovanni Peterlongo (1963) et Enrico Dondi (2006).