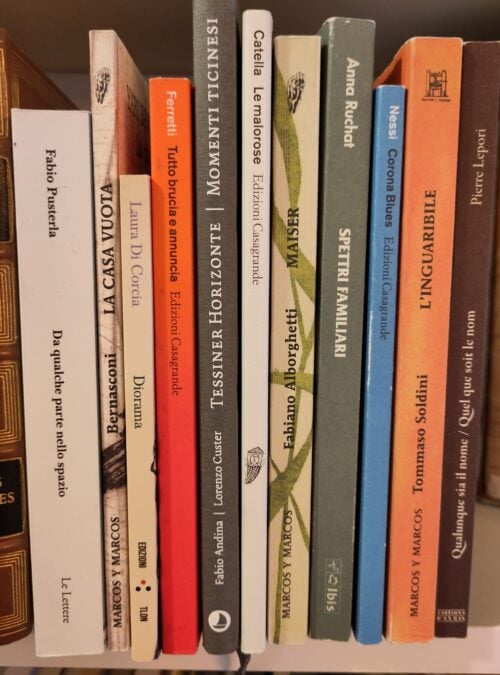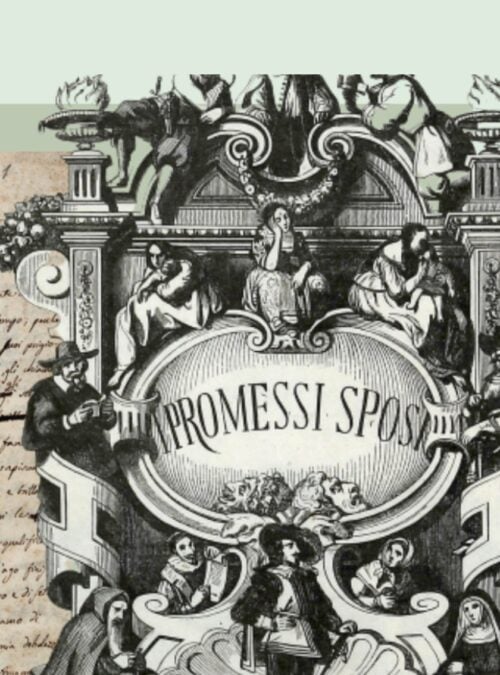Le jeu des traducteurs
Auteur: Veronica Raimo ha curato questo dialogo insieme a Livia Franchini

On m’a souvent demandé quel est le rapport entre mon activité d’écrivaine et celle de traductrice, comment elles s’influencent et interagissent l’une sur l’autre. Je me suis rendue compte que mes réponses ont évolué dans le temps tout comme ma perception de ce rapport. Aujourd’hui j’ai du mal à envisager cette interpénétration nécessaire d’une manière qui concerne seulement mon travail. On n’écrit pas et on ne traduit pas hors de tout contexte. Ce contexte, toutefois, n’est pas seulement dû à la réalité dans laquelle on baigne, mais aussi à la relation avec les autres écrivains et les autres traducteurs. La confrontation avec les autres, en ce sens, ne regarde pas seulement les solutions stylistiques, mais met aussi en jeu des pratiques actives – politiques, éthiques – qui concernent notre vie et nos actions à l’intérieur d’une communauté et d’une langue. Les choses se compliquent et se densifient encore plus si l’on ajoute la question du bilinguisme – à savoir un rapport supplémentaire dialectique entre deux langues – à la relation entre l’écriture et la traduction.
Au départ, j’avais pensé de m’essayer à réfléchir à ces questions avec Livia Franchini, dont j’avais traduit en italien le roman Gusci, paru à l’origine en langue anglaise sous le titre Shelf Life. Pourquoi avait-elle décidé de confier à une autre personne la traduction de son livre au lieu de le traduire elle-même ? Que signifiait cette décision ? Où se place la fontière entre traduction et réécriture ? Avons-nous vraiment besoin de cette frontière ? Comment s’est développée dans le temps la métaphore de la traduction ?
Avec Livia nous avons pensé à étendre ce discours à d’autres écrivaines et écrivains qui se sont posés les mêmes questions. Pour donner une forme cohérente à ce flot d’interventions, Livia a proposé une structure inspirée du renga japonais, poésie « en chaîne » collaborative. En voici le résultat.
Livia Franchini
1) Entre la théorie d’une certaine pratique fluide de la traduction et la pratiquer peut s’instiller un sentiment subtil d’inquiétude, d’illégitimité. « Ah, si je n’avais pas été traductrice, j’aurais été une moins bonne écrivaine, j’ai tellement appris en traduisant ! » : en réalité, c’est un peu un mensonge, car la traduction, au moins pour moi, est la condition essentielle de l’écriture. Traduction entendue comme pratique (en dehors de la théorie), comme acte nécessaire, celui de transporter un matériel de signification d’un lieu à un autre, sans la prétention de remonter à l’original ; mieux, entendue comme la conviction grandissante, empirique que, peut-être, cette matière première n’existe pas ; entendue comme le développement, en un certain sens, d’une étique du recyclage, une « excavation » humble d’un matériel depuis l’expérience jusqu’à la reformulation en quelque chose de signifiant pour quelqu’un d’autre.
2) Je fais de mon mieux (quand je traduis, quand j’écris) et ma méthode est la même : j’emploie ce matériel disponible accablé par l’inquiétude de pouvoir lui donner une forme susceptible d’être comprise. Malgré l’investissement qui est le mien, je sais que traduire c’est toujours perdre quelque chose. Mais je me mets quand même au travail, consciente des limites de mes connaissances. Je sais que le texte me précède, qu’il me survivra, et cela, d’une certaine manière, redimensionne mon rôle, m’appaise et me met en condition de travailler.
3) Traduire m’a enseigné avant tout à accepter mes limites, à accepter ce sentiment de perte. Avant d’accepter cela, je ne réussissais pas à écrire. Est-ce que cette inquiétude est une bonne chose ?
Veronica Raimo
1) J’aime à penser qu’il n’existe pas seulement une inquiétude « invalidante », mais aussi une inquiétude « positive ». Quand j’ai commencé à travailler sur le livre de Livia Franchini, ce « sentiment subtil d’inquiétude » entre théorie et pratique était plus ou moins semblable à une sorte conflit à l’intérieur un « couple ouvert » : le partage de la liberté réciproque se transforme en un élément fortement contraignant, comme si la recherche d’une autonomie propre au-delà de ce rapport « ouvert » comportait une approbation implicite de la part de l’un ou de l’autre. Plus le facteur-liberté est important, plus on a peur de la trahison – étique, esthétique – ou bien d’un mauvais choix, de quelque chose qui affaiblirait ce partage.
2) En revanche, quand mon livre a été traduit en anglais, ce conflit s’est illustré ainsi : mes éditeurs anglo-américains insistaient pour le choix d’une langue complétement détachée de la langue originale, alors que mon traducteur voulait maintenir une sorte d’indiosyncrasie de fond qui, pour lui, équivalait à un acte de fidélité à ma langue maternelle. Il voulait faire sentir qu’il s’agissait bel et bien d’un livre traduit. En un certain sens, nous nous étions donnés moins de liberté, et ceci s’est changé en un rapport gênant, dans lequel la possibilité d’un choix erroné s’effaçait au profit de la tentative de minimiser la possibilité-même de choisir.
3) Que signifie se « sentir libre » dans une traduction, et comment se manifeste le « choix », quand on a un rapport avec l’écrivaine ou l’écrivain que l’on est en train de traduire ?
Francesco Pacifico
1) Chiara Barzini m’a demandé de traduire son roman, écrit en anglais américain et inspiré de sa vie d’adolescente italienne à Los Angeles, après que j’eus réécrit mon roman Class en anglais, pour un éditeur américain. (En autres, dix pages de ce livre ont été traduites pour une revue anglaise par Livia elle-même !). Avec mon éditeur nous avions décidé qu’au lieu de traduire moi-même le livre ou de le faire traduire, je l’aurais réécrit, parce qu’il avait à voir avec les rapports de domination entre l’italien et l’anglais américain et leurs cultures et imaginaires respectifs. Pour cela, il fallait que la critique du pouvoir de langue et de l’imaginaire soit retournée, comme un négatif, et faire que l’italien transparaisse sous l’anglais et non l’anglais sous l’italien comme dans le livre original. Quand j’ai traduit Chiara, une belle dispute a éclaté entre nous. Je la résumerais seulement par la tendresse qui nous a étreint lorsque nous avons parlé ensemble pour la première fois après la sortie de son livre. Comme le dit Veronica, ce travail est un peu comme un « couple ouvert », et Chiara et moi, je le pense, nous nous sommes regardés l’un l’autre, comme un couple se regarde, après avoir créé un vrai « pastis » avec nos désirs et nos fantaisies. Je m’étais plongé dans son livre en y cherchant tous les aspects « méta », comme dans le mien, alors que son expérience de l’anglais était plus directe et naturelle que la mienne.
2) Pour moi l’anglais c’est du latin alors que pour elle l’anglais c’est la langue de son adolescence. J’ai dû accepter cette différence de langage dans l’ordre du désir et du vécu et j’ai traduit cette belle histoire californienne (Los Angeles, sa Valley, son Topanga Canyon) de manière plus directe et naturelle (si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais même laissé pas mal d’anglais dans la traduction italienne, par exemple). Le conflit entre les vérités émotives liées à la parole : c’est pour ça que j’aime vivre « dans » la littérature. Et vivre dans la littérature ce n’est pas vivre dans une pyramide, un classement ; c’est vivre dans une sorte de guerre que l’on mène face à une sorte de mots-croisés sans solution. Je suis d’accord avec Livia, traduire veut dire se tenir dans un lieu d’amour pur pour le langage, justement parce que tu es dans un lieu qui nie la réalité objective du langage – parce que le langage de tous les jours nous semble objectif, et souvent la haute culture fait semblant qu’il le soit. En quelque sorte, les traducteurs « dealent » une langue frelatée avec une sorte de gourmandise criminelle.
3) Quand j’écris, je veux conserver cette gourmandise criminelle que me procure la traduction. La langue n’existe pas et la langue soutenue est une tromperie aspirationnelle. C’est un vrai jeu mythomane. Gadda est mon héros, parce qu’il choisit ses mots au hasard. Je suis en train d’écrire une nouvelle en anglais, et je tiens un journal de bord sur le covid en anglais pour une revue américaine. Écrire en anglais me permet de me détacher des inquiétudes que la conscience de l’italien me provoque. Quand on écrit en italien, on écrit pour le prix Strega, pour le supplément dominical et pour Alias ; on écrit pour se servir des mots d’Arbasino et de Manganelli. Je n’en peux plus d’écrire en italien, parce que c’est une écriture conformiste : une écriture qui se plie aux standards de Nuovi Argomenti et du « Gruppo 63 » ; une écriture prisonnière. En écrivant dans une autre langue (pour le faire en ce moment je lis Conrad, DeLillo et Claudia Rankine), je me prends à rêver à des associations mentales que je ne comprends pas mais que je ressens. Chiara, tu le vis comme ça ? Comment c’était d’écrire, adolescente, en anglais plutôt qu’en italien ?
Chiara Barzini
1) L’histoire de notre « couple » a été vraiment particulière, un rapport orageux et haletant, mais c’était aussi beau et intéressant pour ça. J’ai connu Francesco par l’intermédiaire de Tim Small qui a été une vraie bouée de sauvetage quand je suis revenue vivre des États Unis en Italie, l’un des premiers de « notre » génération à jouer sur la transversalité de la langue et de la culture anglo-saxonne. En 2012, il avait fondé la Milan Review of Literature, une sorte de Paris Review italo-américaine qui portait un regard lumineux sur certains écrivains expérimentaux américains que j’aimais le plus : Nelly Reifler, Deb Olin Unferth, Amelia Gray, Amie Barrodale et Clancy Martin. Avec Francesco, faire parti d’un petit groupe « d’insurrectionnalistes » nous rendait enthousiastes. Nous avions découvert que les revues littéraires pouvaient prendre la forme de nouvelles, de récits, d’entretiens, d’œuvres d’art improvisées en dehors de l’establishment littéraire. Travailler à quatre mains pour traduire un roman ensemble avec la personne qui l’avait écrit à l’origine c’était le défi de Terremoto. Nous avons découvert que c’était comme coucher avec ton amante alors que ton épouse te regarde du pied du lit. Francesco avait, en effet, ce qu’il appelle « une gourmandise criminelle », la volonté de casser, pénétrer, réinventer, alors que moi j’avais un besoin maternel que les choses puissent sonner le plus possible comme dans l’original. Le verbe « traduire », comme Jhumpa Lahiri et Francesca Marciano ont souligné tant de fois lors de nos conversations sur ce thème, a la même racine que « trahir ». Pendant ce moment si fragile du passage d’une langue à l’autre, je n’étais pas disposée à avoir le rôle de l’épouse. Moi, je voulais être l’amante. Comme dans tous les couples qui fonctionnent, nous avons appris à s’accorder de la liberté et ce don est resté.
2) Écrire, adolescente, en anglais au lieu d’écrire en italien s’est fait naturellement parce que l’anglais est la langue de mon adolescence. J’ai écrit en anglais mes premiers récits, j’ai noirci tant de journaux intimes sur la vie de Johnny Depp en couple avec Kate Moss. En anglais, j’ai donné mes premiers baisés et commis mes premières grandes erreurs, mes premières transgressions. C’était la langue qui m’avait aidé à imaginer un monde nouveau. Il y avait une urgence à écrire en anglais. Si je ne l’avais pas fait, je n’aurais jamais réussi à aller à l’école, à m’intégrer. Ça voulait dire rompre avec une partie de moi que j’avais dû laisser derrière moi. C’est une langue envers laquelle je suis très protectrice car c’est la langue qui m’a sauvé à un moment où je brûlais de trouver une vie et une identité nouvelle et c’est une langue qui me parle de « survie ». Réussir à faire parti d’un système, intégrer une université, commencer à écrire pour la presse, devenir ainsi l’écrivaine que je suis aujourd’hui, ça a été un parcours qui a commencé avec l’abandon de l’italien, une langue avec laquelle j’entretiens encore un conflit presqu’infantile.
3) Et parlant du conflit entre italien-anglais et enfance-vie adulte, je ne peux pas ne pas penser à Claudia Durastanti qui a connu un parcours inverse au mien et à celui de nombreux expatriés : New York était le lieu des souvenirs d’enfance et l’Italie celui où elle a débarqué ensuite. Il y a quelques jours, La Straniera (L’étrangère), qui somme toute parle aussi de cela, a été récompensée par le Pen Prize pour la traduction. La dernière fois que nous nous sommes vues à Rome pour la présentation du volume avec Veronica Raimo, tu m’as dit que tu pensais le traduire en anglais. Puis tu as accepté qu’Elizabeth Harris le fasse. Je voudrais te demander la raison de ce choix et savoir si toi aussi, comme Francesco et moi, tu as travaillé à quatre mains ? Es-tu l’épouse ou l’amante ?
Claudia Durastanti
1) Je suis peut-être la méchante sœur jumelle ou celle qui reste piégée dans un miroir. Il me vient seulement en tête des imagines lesbiennes « midcult » du genre Black Swan ou Mulholland Drive : ça n’est pas que moi ou la traductrice avons eu ce genre de relation, mais ce sont l’italien et l’anglais qui agissent en moi de cette manière. J’ai récemment reçu le manuscrit de La Straniera en anglais, après l’avoir attendu un an, et la première chose que j’ai faite a été de pleurer : après tout ce temps, non seulement le livre italien a commencé à s’estomper voire disparaître sous certains aspects, mais maintenant qu’il m’est parvenu dans sa langue primitive inconsciente il résonne vraiment comme si ce n’était pas moi qui l’avait écrit ; on dirait même que le texte a subi comme une mutation génétique. Probablement l’ai-je fait traduire par Liz Harris pour cette raison, je ne voulais pas manquer de vivre une chose comme celle-là, de vivre une sorte de séparation supplémentaire. Désormais, j’ai vraiment envie de défendre le talent et la créativité de Liz, cette radicalité de la distance, alors qu’au début j’étais convaincue d’intervenir beaucoup plus, et qu’il aurait été logique, voire de bons sens, d’assister la traductrice. Mais si ça avait été le cas, tout le « jeu » sous-jacent à mon choix n’aurait servi à rien. Plus que traduire, si j’avais travaillé sur La Straniera en anglais, j’aurais couru le risque de le réécrire, de le transformer en une sorte d’œuvre ouverte inachevable. Alors que là je réussis à me passionner à nouveau pour les histoires qu’elle contient, mais je les lis comme si elles étaient celles d’une autre écrivaine qui aurait écrit ces dernières années une narration hybrique, dans une dynamique presque de « répudiation » qui me semble « génératrice » : d’une certaine manière, tout ce que j’écrirai à partir d’aujourd’hui, les prochaines réflexions théoriques que j’aurai sur la traduction, tout cela s’enkystera dans cette expérience.
2) Somme toute écrire sur la traduction traduction, plus qu’écrire influencée par la traduction – comme Livia je ne réussis pas à imaginer une pratique sans l’autre tant elles se modèlent et se déconstruisent l’une l’autre – c’est une nouveauté de ces dernières années pour moi. J’ai découvert que c’est réellement un « micro-genre » littéraire qui me satisfait beaucoup. J’ai une forte aversion pour les « personal essay » de tout type en ce moment sauf s’ils proposent un raisonnement sur la langue et sur la transformation de la langue qui pourrait être une clé de lecture différente des romans classiques ou contemporains ou qui pourrait apporter une interprétation nouvelle d’autres arts. Je me rends compte que pour éculée et sollicitée qu’elle soit, la métaphore de la traduction se renouvelle toujours dans mon cas.
3) Si écrire dans une autre langue me fait penser au travestissement, au théâtre et aux jeux de rôle, se traduire dans une autre langue requiert inévitablement une sorte de tourbillon psychanalytique infini dans l’ordre du détachement de soi. C’est un mécanisme tellement « auto-évident » qu’il ressemble à une petite histoire « bourgeoise » dans les mains d’un analyste à la petite semaine. Et pourtant, pour identifiables et prévisibles que soient les mécanismes psychologiques, je crois que chacun d’entre nous produit avant tout des réponses de défi ou s’illusionne sur sa capacité à apporter une solution personnelle à un dilemme universel. C’est pourquoi pour moi la question « comment c’était d’écrire dans une autre langue ? » a encore du sens. Et pour toi Illaria ?
Ilaria Bernardini
1) Écrire dans une autre langue a provoqué une révolution. Je ne m’étais jamais mesurée à ce point avec l’idée de l’altérité, de l’ailleurs, d’autrui, avec tous les à-côté que produit le fait de s’autoriser à utiliser ce qui appartient à quelqu’un autre, en plus du thème de la trahison/traduction (il m’arrivait de le faire pour un livre dont la trahison est au cœur de la trame et, de fait, chaque pensée que j’ai eue en ce sens a eu une certaine résonnance). J’ai même essayé de ne pas le faire parce que j’étais terrorisée, mais quand j’ai commencé avec l’italien, j’ai cru faire semblant, je ne croyais plus aux personnages et ce à chaque phrase, et « le jeu mythomane » dont parle Francesco n’aurait pas pu fonctionner : l’italien aurait été une traduction, la traduction d’un sentiment, d’une sonorité, la trahison de toute une histoire. Il ritratto se déroule en effet à Londres, les personnages et toutes les personnes parlent en anglais (celui de ceux qui viennent des quatre coins du monde, la langue de « l’être étranger », un peu tordue, avec des pauses plus longues, avec l’accent et les inflexions qui trahissent votre origine, sans nuances, un peu à la Lost in translation car on est soi-même lost in translation ; une langue apprise dans les livres, les films, les chansons, les années passées ailleurs). Quand j’ai débuté, je ne savais si j’avais une « voix » littéraire en anglais. J’ai expérimenté et j’ai mis longtemps à le comprendre. Le temps, voilà ! L’anglais m’a vraiment obligé à aller plus lentement, à former mes idées à un rythme bien différent de celui auquel je suis habitué : en italien j’écris vite, fougueusement. J’écris trop, j’écris sachant de savoir faire certaines choses que, par chance, je ne sais pas du tout faire en anglais. Cette langue m’a permis de ne pas toujours écouter la même petite voix qui parle en moi, mais d’habiter, d’utiliser vraiment une voix différente. J’ai même remarqué qu’en anglais je parviens à être plus sentimentale, d’une manière dont je n’ai pas honte, à dire des choses qu’en italien je ne réussirais jamais à dire et à écrire. Je demande si cela a à voir que rien ne m’est jamais arrivé ni de terrible ni de très beau en anglais : ce n’est pas ma langue maternelle. Je n’ai jamais connu ni jouissance ni souffrance en anglais, je crois d’ailleurs n’avoir jamais urlé en anglais. Il n’est pas inscrit dans mon passé et au présent je n’ai jamais ni aimé ni detesté en anglais.
2) À la différence de Chiara et Livia, qui écrivent en anglais après avoir vécu ou vivant encore pour de vrai à l’étranger, pour moi l’anglais n’est pas réellement représentatif d’une période de ma vie : c’est une espèce de continuité. Et pour cela justement l’ailleurs reste l’ailleurs : on y arrive toujours et toujours on en repart. L’anglais n’est même pas la seule autre langue dans ma vie : j’ai grandi avec le français et je vis une grande partie de l’année en Espagne. Justement pour cela – parce que je me retrouve et je me perds dans plusieurs langues – je me demande toutefois si c’est seulement avec l’anglais qu’existe cette possibilité plus large « d’ailleurs » d’émotions, de créations, voire même « d’ailleurs » politique. Je veux dire un « faire », un « produire » et un « recevoir » qui est à l’origine d’un « faire »/ « donner » collectif. Je me demande ce que provoque ce « faire » des « ponts », des « maisons », ce « faire » de l’ailleurs quelque chose de presque familier, de presque compréhensible par le plus grand nombre. Je me demande si au moins quelques idées – que nous réussissons à partager dans notre jeu à trois strophes – s’appliquent à cette circularité évidente et lumineuse de la pratique d’une langue – qui désormais depuis très longtemps – a ce rôle de langue universelle qui fait que l’on se parle et se comprend même loin de son propre pays. Je me demande comment auraient pu changer ou inversement seraient restées inchangées les choses que nous avons écrites. Peut-être toutes d’ailleurs mais nous ne pourrons jamais le savoir (sinon en nous imaginant en immersion traduire ou être traduits dans un dialecte que parlerait seulement trente personnes sur terre, repésentants d’une culture lointaine à laquelle nous n’aurions jamais été exposés d’une manière ou d’une autre : une altérité plus brutale, une vraie perte de soi). Je me demande quelles différences il y a – s’il y en a – entre traduire la langue connue de tous et traduire ou écrire dans une langue peu connue – moins lue, moins chantée, moins diffusée en film ou sur des vidéos youtube, moins écrite sur les portes des toilettes).
3) Quand j’écris en anglais, je ne lis que de l’anglais et quand j’écris en italien je ne lis que de l’italien. Mais je me suis rendue compte, en choisissant quoi lire durant The Portrait, que certains livres que je redécouvrais à cette occasion n’avaient plus la musicalité à laquelle j’étais attachée et que je voulais retrouver : ils appartenaient à la version que j’avais lue, l’italienne. Ils appartenaient à celle que j’étais alors quand je les lisais, à quinze ans. L’expérience de les relire en anglais a comporté des acquisitions mais aussi des pertes : la dimension affective qui m’avait émue je ne l’ai plus retrouvée. Au-delà de la perte de quelques phrases, j’ai perdu une partie de moi, à laquelle je ne peux plus accéder (mais peut-être c’est comme ça pour tout, relire un livre dans la même langue et traduit avec le même esprit de mes quinze ans, traduit avec celui de mes trente ans et encore au-delà, près de la mort, comporte un écart continue, une nostalgie permanente). Quand j’ai réécrit le livre en italien, la bataille pour retrouver ma propre musicalité, pour retrouver ma voix qui n’était plus ma voix, a été violente, claustrophobe. J’étais comme une étrangère dans ma propre maison. Et à la maison il y avait de nouvelles règles, des restrictions, et ces règles et ces restrictions ne m’étaient d’aucune aide : avant j’étais libre ! Pendant un an, il m’était insupportable, par exemple, d’employer le passé simple – je déteste écrire « feci ». C’est seulement en relisant les américains traduits en italien, que j’ai réussi à faire la paix avec ce temps verbal. Le passé simple ne m’a jamais dérangé en tant que lectrice italienne ; il me dérangeait seulement en tant qu’écrivaine italienne, seulement si je pensais qu’avoir écrit en angalis avait détruit ma liberté en italien. Ce phenomène est identique en quelque sorte pour le titre d’un livre : il conduit à perdre ou à trouver de nouveaux sens en raison de la différence avec l’intention originale, le cœur pour nous de l’histoire que nous avons écrite, l’intention plus mystique, secrète, la recherche existentielle expérimentée et d’une certaine manière achevée à travers l’acte créatif. Je pense à Shelf Life/Gusci. Mais aussi à Things That Happend Before the Earthquake/Terremoto (mais dans ce cas-là s’agit-il des choses qui sont arrivées avant ou le tremblement de terre lui-même ? La différence chronologique induite par le titre change-t-elle la compréhension du livre en Amérique ou en Italie ?). Je pense surtout à Miden/ The Girl at the Door : le focus est-il mis sur la société ou sur la jeune fille ? Qu’est-ce que le titre raconte là précisément, au-delà du livre, et dans quelle mesure ce changement de titre changera notre expérience de l’histoire une fois que nous serons dans le livre ? Si tu relis le même livre avec un autre titre, qu’est-ce que tu ressens ? Est-ce que l’histoire change un peu, comme par magie, avec un autre livre ?
Veronica Raimo
1) Je n’ai jamais aimé le titre anglais The Girl at the Door : il me semblait faire écho à un genre de livres qui n’a rien en commun avec le mien. J’ai insisté pour Miden, mais à un certain moment on m’a appris qu’en argot écossais ça voulait dire « chiotte », chose qu’en réalité je n’ai jamais réussi à vérifier (si c’est une blague pour me faire changer d’avis, je la trouve géniale). Néanmoins il est vrai que la lumière s’est déplacée de la communauté sur l’un des personnages : celui qui déclenche l’histoire, mais qui, par la suite, n’apparaît presque plus. Et là est survenue une autre problématique. Au Royaume-Uni et aux USA, le livre est vendu comme « le premier roman post-Weinstein », pour citer le Vanity Fair italien. Moi, je l’avais terminé avant l’affaire Weinstein, donc pour moi le rapport dialectique avec la réalité au moment de l’écriture était bien différent de celui que suggère ce slogan. La réception du livre dans le marché anglo-saxon a pâti de cet écart cognitif : le premier roman post-Weinstein dans lequel la « victime » est réduite au silence, alors qu’on choisit de mettre en lumière son présumé « violeur » a semblé une odieuse provocation. « Je ne pense pas que nous ayons encore besoin de romans qui nous rappellent combien l’image du viol peut être différente d’une personne à l’autre » a écrit, par exemple, un blogeur, « cette idée n’est pas seulement dérangeante, elle est dégoûtante ». Ensuite, on s’est demandé s’il pouvait y avoir éventuellement un problème de langue : « Je ne sais pas comment sonne l’original, mais dans la version traduite je ressens de la vulgarité, du scabreux et un voyeurisme effrontément désagréable. Je me suis sentie sale (« dirty ») en lisant The Girl at the Door, une sensation que, je l’espère, plus personne n’aura en lisant un livre ». Narcissiquement, je pourrais être satisfaite d’avoir provoqué un tel remou, mais je ne voulais absolument pas que quiconque se sente « dirty ».
2) On dit toujours qu’une fois le point final posé, un livre n’appartient plus à son auteur, mais au lecteur. Je ne suis pas tout à fait d’accord. Je me borne à constater que la réception de Miden, comparée à celle de The Girl at the Door, a été non seulement très différente, mais aussi contradictoire. En Italie, on a pris mon livre pour un roman féministe qui s’interrogeait sur la question du consentement, au Royaume-Uni et aux USA pour un roman ambiguë idéologiquement qui tendait à une certaine empathie envers le coupable. La vérité c’est que la contradiction faisait partie du livre lui-même : j’ai essayé d’imaginer – avec des instruments littéraires – les conséquences d’une bureaucratie du langage et du désir dans une société où l’on cherche à éliminer le conflit. En quelque sorte, le conflit m’est revenu en pleine figure. La polarisation entre le politiquement correct « prescriptif » et une incorrection politique libertaire me paraît aujourd’hui dangereuse. Dans le débat sur le consentement, on a en quelque sorte dédouané aujourd’hui la « zone grise », mais il est plus difficile de trouver une « zone grise » entre ces deux rhétoriques, autant qu’il est difficile de trouver un langage pour interpréter et raconter la violence. Cette prétendue « zone grise » présente également des différences selon le contexte culturel.
3) On se demande toujours si la littérature peut ou doit être en mesure de raconter tous les points de vue (avec la jurisprudence Lolita), mais ce qui m’intéresse c’est plutôt de savoir avec quelle langue on peut et on doit dire aujourd’hui la violence. À quel point le mimétisme est-il dangereux ou légitime ? En quelque sorte, le livre de Livia Franchini a à voir avec cette question, et je voudrais savoir comment elle l’a traitée et si, elle aussi, a connu une réception différente en Italie et au Royaume-Uni.
Livia Franchini
1) Ce que j’écris, coupable, ou vertueusement responsable, se fonde sur la pratique de la traduction qui est la mienne. Cela ne provient presque jamais d’un exemple de représentation, mais, si l’on veut, d’une drammatisation, d’un échange. Il y a toujours, pour moi, au moins deux pôles – celui qui parle et celui qui écoute – et ces rôles ne sont pas figés ; ce n’est pas toujours moi, l’auteure, qui parle et le lecteur qui écoute. La relation que je cherche – mieux, la seule que je sens possible – est de caractère horizontale : la narration se fait ensemble, avec une même responsabilité. C’est pourquoi proposer un instantané du conflit ne m’intéresse pas, je préfère plutôt le mettre en scène, le problématiser, l’offrir à l’interprétation, le faire dialogue. Le coût qui en découle est un effort créatif que j’espère payant comme dans toute conversation qui se respecte. Le concept anglais de meaning-making (« faire sens ») me plaît et je suis convaincue qu’il s’agit d’un processus collectif. Je veux parler de conflit, dans un sens plus large, et non particulièrement de violence de genre, malgré le fait qu’il existe un parallèle sur ce thème entre mon travail et celui de Veronica, parce que je crois que la question est plus invasive et qu’elle ne s’arrête pas au sujet d’un livre, mais qui a à faire avec toute l’interaction humaine et avec les rapports de pouvoir qui la structurent. Pour dire ce conflit, nous avons à notre disposition des techniques littéraires qui n’ont rien à voir avec le réalisme : la représentation est peut-être la manière la plus directe à travers laquelle on peut se rapprocher de la narration des rapports de pouvoir qui structurent la (les) société(s) dans laquelle (lesquelles) nous vivons, mais nous ne devons pas oublier que le réalisme contemporain est déjà passé par le chas de l’aiguille du post-modernisme. Il ne s’en remet plus à l’illusion d’un narrateur omniscient, mais il revendique la subjectivité de l’expérience et avec elle le « poids » politique du sujet marginalisé. La slice of life contemporaine est plus semblable à une photo de famille qu’à une photo aérienne. Dans ce contexte, si une urgence représentative des rapports de pouvoir contemporains me semble absolument légitime – en particulier lorsqu’ils peuvent mettre la lumière sur des récits qui historiquement sont passé sous silence par un establishment littéraire qui préfère ce qui lui ressemble -, par contre imposer un quadre interprétatif qui s’en tient au réalisme me semble résulter d’une lecture qui met en avant seulement sa propre objectivité, la perception individuelle du réel. Dans le cas de Miden, c’est une lecture insuffisante, étant donné que l’on parle d’un roman de speculative fiction, genre qui depuis toujours représente un laboratoire privilégié pour repenser le conflit entre la construction de mondes avec des règles différentes du nôtre. Dans l’espèce, la représentation de la violence de genre devient « productive », dans Miden, justement en situant le conflit à cheval entre deux sociétés avec des approches différentes à la régulation du désir, et ce n’est pas un hasard s’il sert de passerelle entre deux points de vue équivalents que le lecteur doit activement prendre en compte. Si Miden met mal à l’aise, tant mieux. C’est le contraire qui me préoccuperait par rapport à ce qu’il raconte et comment il a choisi de le faire.
2) À ce point, différents facteurs complexes entrent en jeu, et si je ne peux rien dire sur le contexte américain, je peux essayer, en revanche, d’avancer quelques hypothèses sur le contexte anglais que je connais mieux. Dans le monde anglophone, on met en avant le fait de s’interroger sur la nature du conflit de pouvoir, ce qui me semble une action sacrosainte et urgente, puisqu’elle implique une série de réflexions nécessaires sur ce que, en tant qu’écrivaines, nous voulons « mettre en circulation » dans le monde. Cela veut dire, au moins pour moi, de bien s’interroger sur les espaces que nous nous approprions, comment on nous garantit l’accès à ces mêmes espaces, comment le pouvoir et le privilège, que nous avons en quelque sorte accumulés pour le faire, peuvent nous aider. Ce processus pour moi a été et continue à être précieux, parce qu’il encourage un sens de la responsabilité politique dans ma pratique créative, qu’il serait réducteur de réduire à un « politiquement correct » de surface. Avec les histoires on construit le monde : un roman tient dans un rapport partagé avec la réalité, la reproduit et en même temps la produit à travers ses formes, et donc nous avons la responsabilité de judicieusement choisir pour ne pas reproduire passivement, sans critique, les rapports de pouvoir qui nous écrasent et qui écrasent ceux qui ont moins de pouvoir que nous.
3) Et cependant, comme le démontrent les faits à propos de The Girl at the Door, cette réflexion ne peut être réduite à des lignes-guide vertueuses applicables sytématiquement : la prétention de développer une best practice pour l’écriture contemporaine à partir du contexte anglophone révèle l’hubris impéraliste du contexte lui-même. Une recension qui critique un roman en traduction sur la base d’un choix marketing, qui le décrit comme « post-Weinstein », part du présupposé que ce choix marketing est une vérité absolue qui définie la nature-même du roman, en élimine le monde, le contexte, l’altérité naturelle, pour l’assimilier au débat anglophone contemporain et le réduire à un bien de consommation dont on peut jouïr immédiatement. Cet exemple de marketing est « envahissant », dans le monde de l’édition anglaise, et malheureusement, dans un sens plus large, dans le débat politique britannique : le lecteur prosumer se plaint sur Goodreads quand il n’a pas compris la fin d’un livre, le jeune électeur porte un t-shirt avec le logo de Nike avec dessus écrit « Corbyn », en pleine pandémie le buisiness des masques en lin écologique est florissant sur Etsy. Il s’agit d’une démarche critique qui s’arrête, trop souvent et même avec les meilleures intentions, à une réglementation des exemples individuels du conflit parce qu’elle ne met pas en discussion (au contraire de ce que fait Miden) la surface glissante du réel et de ses possibilités de narration. Dans les mouvements de « social justice » contemporains nés dans un contexte anglophone, la marginalisation du problème du langage est frappante : l’illusion, pour qui parle seulement anglais, que sa propre langue correspond à la réalité, au lieu d’une structure de la réalité bien située. Je ne dis rien de neuf : Wilhem Von Humboldt, il y a deux cents ans tout rond, théorisait que la diversité des langues n’était pas réductible à une différence de sons et de signes, mais manifestait une diversité de visions du monde. Exister et écrire en traduction veut dire se faire véhicule de cette diversité, et, en revanche, « ci tiene » tient bien à l’esprit l’importance du contexte : nous sommes, par nature, des lecteurs plus actifs et des écrivains plus humbles, dans notre étroitesse consciente, dans notre subjectivité consciente. Peut-être meilleurs ? Qui sait. Je ne connais pas d’autre manière; je ne le voudrais pas.