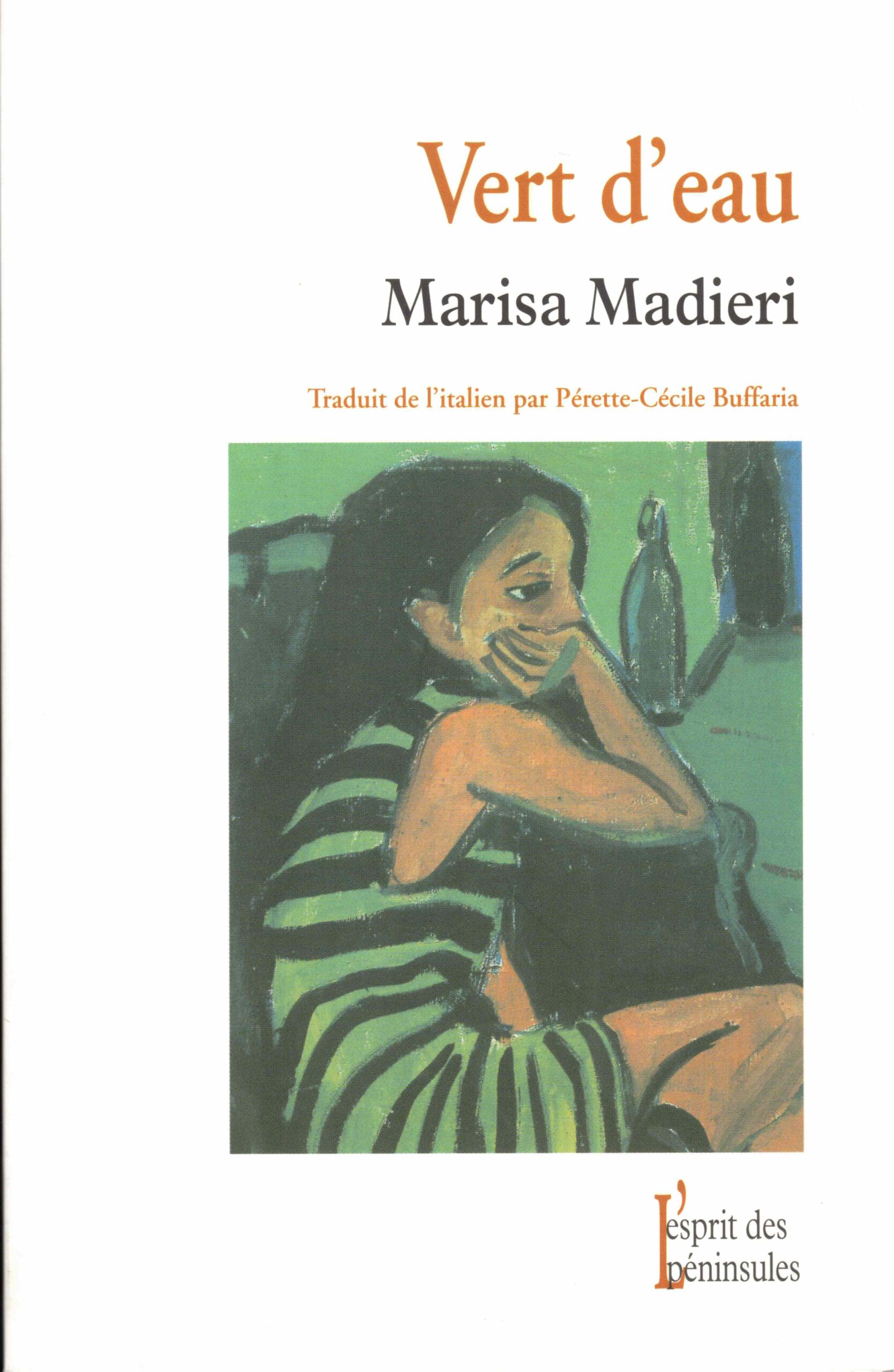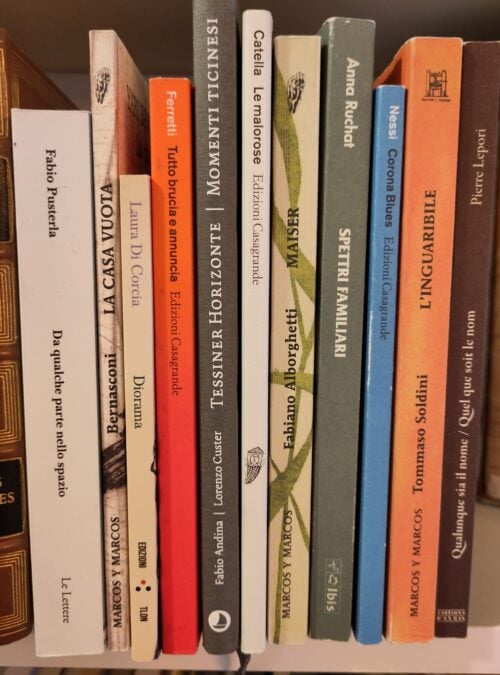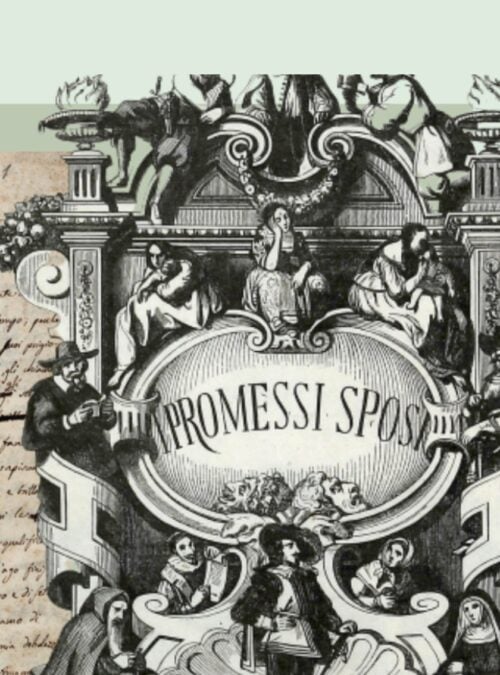Échos de Trieste dans l’édition française (seconde partie)
Auteur: Laurent Feneyrou (CNRS)
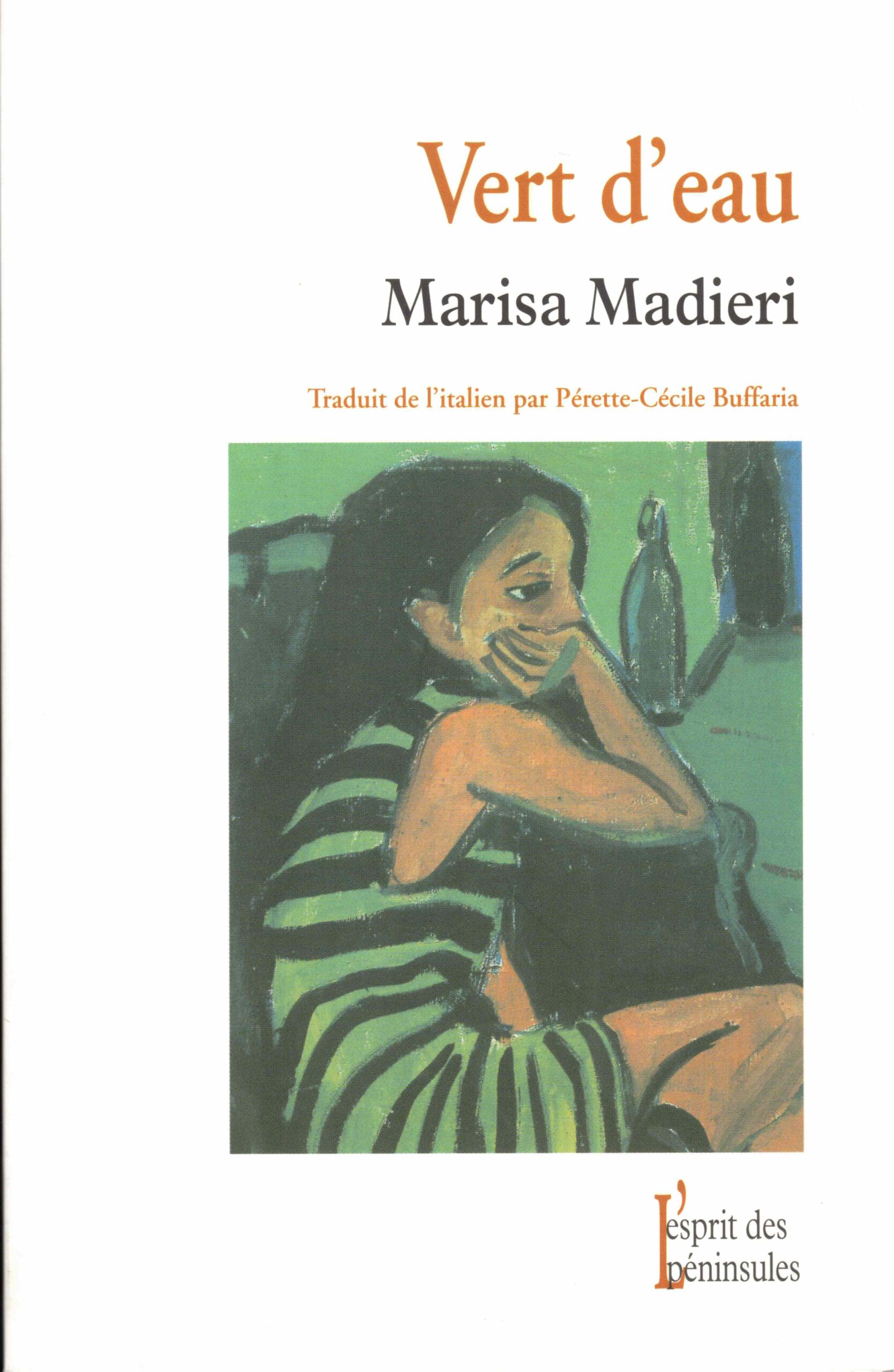
Dans la période complexe de l’après-guerre, deux romanciers sont traduits en français, souvent dans ee sillage immédiat de leurs publications originales : Pier Antonio Quarantotti Gambini, dès 1949, avec Les Régates de San Francisco, avant plusieurs autres romans et recueils de vers ou de proses que préface, à l’occasion, André Pieyre de Mandiargues (La Vie ardente en 1964 ou Soleil et Vent en 1982) ; et Renzo Rosso (Un été lointain en 1963, qui laisse ouvertes les fractures de sa ville, et L’Écharde en 1965 ; les nouvelles des Hommes clairs suivront en 1989).
Parallèlement, en 1962, paraît la première traduction de vingt et un poèmes d’un maître de la littérature, Umberto Saba. Grâce à René de Ceccatty, Franc Ducros, Georges Haldas, Odette Kaan, Gérard Macé, Bernard Simeone et Frank Venaille notamment, nombre de volumes suivront : outre un choix de lettres (Moi et les autres, 1989), le roman Ernesto (1978, nouvelle version en 2010), relatant abus et étapes dans l’initiation sexuelle de l’adolescent Saba, divers recueils de récits, de nouvelles et d’aphorismes (Comme un vieillard qui rêve, 1983, Couleur du temps, 1985, Ombres des jours, 1990, Femmes de Trieste, 1997), ainsi que d’autres anthologies, sertissant la traduction, à plusieurs voix, du Canzoniere (1988). Là, le chant de l’introversion, marqué par la névrose et les années de la psychanalyse, atteint une grâce, une transparence, la limpidité de cose leggere e vaganti, une sagesse qui paraît un don amer, patiemment acquis, empreint de mélancolie et d’idyllisme, jusqu’à une dimension universelle. L’acceptation de la vie tout entière, douce et cruelle, n’est pas sans risque, comme traversée de désirs obscurs, d’insupportables angoisses, d’une crainte et d’un attrait de la mort. « Le Canzoniere est l’histoire (nous n’aurions rien contre le fait de parler de “roman” ni d’ajouter, si l’on veut, “psychologique”) d’une vie, pauvre (relativement) en événements extérieurs ; riche, parfois, jusqu’au spasme, de mouvements et de résonances intérieures, et de personnes que le poète aima au cours de cette longue vie et dont il fit ses “figures” », comme l’écrit Saba.
Depuis les années 1980, la connaissance française de la littérature triestine s’approfondit. Quelques titres : Le Jour du jugement (1981), La Véranda (1989), De Profundis (2012) et le recueil d’écrits juridiques et politiques L’Avertissement de Socrate (2019) du sarde, devenu éminente figure de l’Université de Trieste, Salvatore Satta, traduits pour les premiers par Nino Frank, pour les seconds par Christophe Carraud ; Le Fantôme de Trieste d’Enzo Bettiza (1986), roman d’une ville scindée, au bord des chaos nationalistes et bellicistes ; l’odysséen Capitaine au long cours (1987), les Lettres éditoriales (1999), sévères et avisées notes de lecture, et le souvenir de Trieste (2000) de Roberto Bazlen ; La Vie meilleure (1987), un siècle d’histoire dans un village d’Istrie, et L’Héritière vénitienne (1991) de Fulvio Tomizza, proposées par Claude Perrus ; La Frontière (1990) et Procès à Volosca (1991) de Franco Vegliani, lancinantes méditations sur le choix, la loi et la violence ; Les Métamorphoses d’Alma (1992) et La Plus Belle du royaume (1994), déconstruction grotesque et inquiétante, implacable, d’un ordre rigide et clos, de Stelio Mattioni ; la concise et douloureusement désillusionnée Notre Maîtresse la mort (1992) de Giorgio Voghera, dans la version de Carole Walter, bientôt suivie d’autres ouvrages ; Le Secret (1996) de l’Anonyme triestin, radiographie d’un amour adolescent inavoué, où le sentiment s’analyse plutôt que de se vivre, contrariant l’existence même ; le récit, en forme de journal, de l’exil depuis l’ancienne Fiume (Rijeka) dans Vert d’eau (2001) et la sensible et grave fable La Clairière (2004) de Marisa Madieri ; la Confession téméraire (2019) et le Journal 1944-1945 (2021) d’Anita Pittoni, qui brilla dans la littérature comme dans les arts décoratifs, et dont les Edizioni dello Zibaldone publièrent, dès 1949, des livres si soignés d’écrivains triestins les plus essentiels.
Cessons-là cette liste, pour conclure sur cinq derniers auteurs.
Il est encore trop tôt pour mesurer, en France, l’apport considérable de Giani Stuparich à la littérature triestine et plus généralement italienne. Certes, ont été traduits son roman Ils reviendront (1988), fresque de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle tomba son frère Carlo, entre les troupes au front et la ville dans l’attente, le bouleversant récit L’Île (1989), où un père, malade, et son fils abordent à Lusinpiccolo, au large de l’Istrie, Femmes dans la vie de Stefano Premuda (1990), qui recueille certaines interventions à la prestigieuse revue Solaria, Trieste dans mes souvenirs (1999), compendium des Lettres triestines, des cafés qui en accueillirent les figures prééminentes, des périodiques et des amitiés dans les tourments de l’histoire, ainsi que L’Année 15 (2019), témoignage humble, à l’os, d’un engagé volontaire au plus près de la soldatesque italienne. Mais il reste tant à faire avec son désenchantement, avec sa droiture morale et politique où se mêlent idéaux nationaux et exigences humanistes et démocratiques, avec ses poèmes, ciselés pour Lo Zibaldone d’Anita Pittoni, et avec les racconti, dont Quarantotti Gambini offrait en 1961 une conséquente anthologie : Il ritorno del padre.
Parallèlement paraissent les traductions du philosophe Carlo Michelstaedter : La Persuasion et la Rhétorique (1989), l’Épistolaire (1990), les Appendices critiques à La Persuasion et la Rhétorique (1994) et le Dialogue de la santé et autres textes (2004). Posthume, Michaelstaedter l’est en ce qu’il ne publie rien de son vivant et met fin à ses jours à 23 ans, aussitôt les Appendices critiques achevés, mais aussi en raison de sa réception tardive, lors de la redécouverte, au cours des années 1970, des cultures d’Europe centrale du début du siècle. Dans une Gorizia, dont l’éminent « glottologue » Graziadio Isaia Ascoli était originaire, où se croisent philosophes et germanistes, parmi lesquels Enrico Mreule et Ervino Pocar, et dont la communauté juive sera presque entièrement exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris Emma Luzzatto, la mère de Michelstaedter, et l’une de ses sœurs, cette œuvre radicale, éprise d’absolu, assoiffée de la plus intense lumière, pense en grec, langue maternelle de la culture occidentale. Lecteur de Platon et d’Aristote, Michaelstaedter ne considère pas l’Antiquité selon son temps, mais mesure notre modernité à l’aune de la sagesse ancienne.
Deux anthologies, Dans le silence le plus tendu (1983) et Les Litanies de la Madone et autres poèmes spirituels (2020), traduits le premier par Laïla Taha-Hussein, le second par nos soins, donnent à entendre la voix puissante et sensuelle du poète de Grado Biagio Marin, dont l’œuvre, insulaire, presque d’un bloc, vibre en dialecte de motifs admirablement colorés, par des mots invariants, quelques centaines tout au plus, moins d’un millier assurément, et par sa forme, célébration du quatrain, modèle de ses sources populaires. Aussi Pier Paolo Pasolini voyait-il en Marin un homme « bloqué », dont la litanie est le genre, en miroir des siècles et des années aussi immuables que les heures : le « non-temps » de la mer, du ciel ou des sables lagunaires, sub specie aeternitatis, comme si ce monde et celui de l’au-delà ne faisaient qu’un.
En 2015 paraissent les Notes inutiles, journal dans lequel Virgilio Giotti écrit le deuil de ses deux fils, disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont il vient d’apprendre la mort de l’aîné. Giotti est un poète des humbles, des vaincus, de l’éthique de la pauvreté, de la beauté simple du monde, de sa caducité et de sa vanité, de la fuite des heures, inexorablement, de la solitude inhérente à l’existence, des douleurs universelles de l’homme, d’un désespoir aux accents de stoïcisme et d’une réserve empreinte de vifs et colériques accès de mélancolie. Pour ce povero alegro, ce qui importe, c’est la tendresse pour les êtres chers et sa manifestation ultime : la compassion. Aussi Giotti chante-t-il, avec pudeur, la maison, les ombres qui l’habitent, les fleurs et les objets, harmonieux et propres, qui maintiennent un semblant d’ordre, le désir perdu d’être auprès des siens, la folie et les tragédies de la vie domestique. Une intuition et une écriture de cette vie, dont les contours se dissolvent en mythe, et où le foyer se fait éternel.
Enfin, l’auteur qui incarne désormais la littérature de Trieste est, à l’évidence, Claudio Magris, dont un premier volume, Enquête sur un sabre, paraît en 1987, avant que Jean et Marie-Noëlle Pastureau ne traduisent la plupart des ouvrages suivants, romans et essais. Qu’il suive les méandres d’un fleuve et, à travers lui, peigne une Mitteleuropa aux blessures jamais cicatrisées, et si méfiante envers l’Histoire qu’elle s’abandonne à un sens du possible, à défaut du réel (Danube, 1988), qu’il étudie la littérature autrichienne moderne à l’aune de l’État supranational voulu par les Habsbourg, de son écroulement en 1918 et de ses soubresauts tardifs (Le Mythe et l’Empire, 1991), qu’il relate l’errance d’Enrico Mreule, disciple de Michelstaedter, de la Patagonie à l’Istrie (Une autre mer, 1993), qu’il mesure la crise de la fin du xixe siècle, nietzschéenne, comme révolte de la vie contre la culture et mise à nu, ni régressive ni irrationaliste, des contradictions, instaurant de nouveaux modèles (L’Anneau de Clarisse, 2003), Magris, par son érudition et l’évidence de sa langue, vise une vérité. « Trieste, plus peut-être que d’autres villes, est littérature, sa littérature ; Svevo, Saba et Slataper sont moins des écrivains qui y sont nés, qui en sont nés, que des écrivains qui l’engendrent, qui la créent, qui lui donnent un visage, lequel autrement en soi, comme tel, n’aurait peut-être aucune réalité. »
Puissent de futures traductions faire entendre autant de traits inouïs de Trieste.