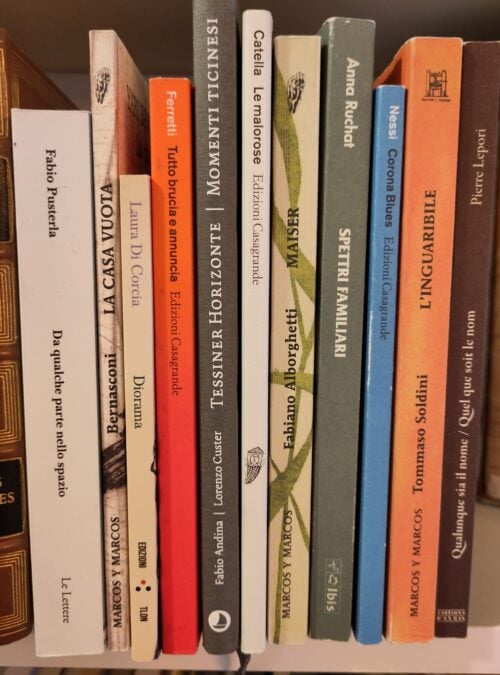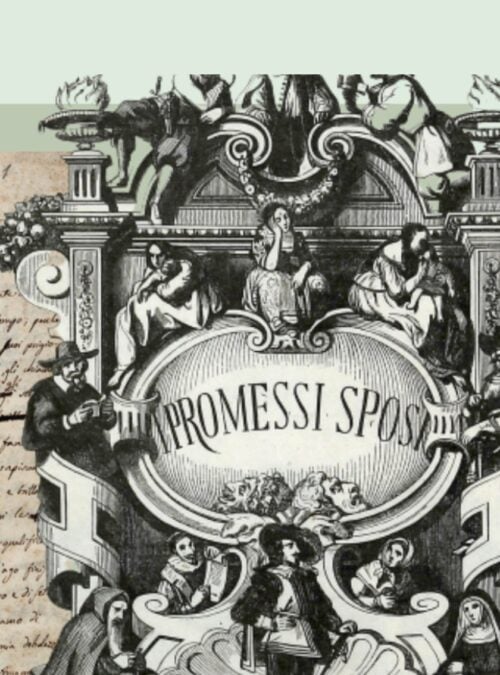Le livre italien en Serbie
Auteur: Snezana Milinkovic, Université de Belgrade

La traduction est à la fois contagieuse et rebelle. Contagieuse parce que le traducteur qui repère un «virus» fascinant dans un contexte linguistique et culturel précis se met aussitôt en quatre pour le transmettre aux autres ; rebelle car ceux qui prêchent l’inviolabilité (sacro-sainte) de l’environnement auquel ils appartiennent doivent toujours être en alerte pour faire face aux «contaminations» qu’ils redoutent plus que tout. En réalité, un peuple/une nation est vivant dans la mesure où sa culture est également vivante, ou, si l’on veut, s’il est capable d’échanger et de changer, en répondant à des sollicitations venues de l’extérieur. Comment, en effet, pourrait-on expliquer autrement le parcours à la fois parallèle et commun jusqu’à aujourd’hui de toutes les cultures européennes à travers les périodes essentielles des Lumières et du Romantisme?
La thèse selon laquelle la traduction doit être considérée non seulement comme un véhicule, mais surtout comme l’activité fondatrice par excellence de la culture, a été répétée lors d’une conférence organisée en 2017 par l’Institut culturel italien de Belgrade qui était consacrée aux «Cultures en traduction : un paradigme pour l’Europe». À cette occasion, l’examen spécifique de l’ensemble des relations entre l’Italie et la Serbie a mis en évidence un point de départ qu’il faut situer à la fin de la période des Lumières, c’est-à-dire à une époque déjà imprégnée, des deux côtés, par des mouvements de revendications identitaires et nationalistes. À ce moment-là, dans le cadre d’un système de valeurs désormais largement uniforme, un groupe d’intellectuels serbes se rapprocha des doctrines venues de l’autre rive de l’Adriatique. Bref, l’accès aux théories des Lumières se faisait dans les Balkans à travers le filtre italien. Parmi les noms de ceux qui peuvent être considérés comme les initiateurs de la culture et de la littérature serbes il faut citer celui de D. Obradović, le fondateur de l’Université de Belgrade, qui s’insipira de l’Etica de F. Soave, celui de J. Vujić, qui traduisit Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno de Giulio Cesare Croce et Adriano Banchieri, celui de E. Janković, qui s’était signalé pour son adaptation de Goldoni, et celui de J. Pačić, qui s’inspira pour son chansonnier des rimes de Pétrarque à travers les poètes de Dubrovnik.
Loin de s’interrompre, la pénétration innovante de la culture italienne en Serbie connut bientôt une accélération décisive, qui vint parachever ce que l’on a appelé l’ère des «Due Risorgimenti», pour reprendre le titre d’un important ouvrage de N. Stipčević (le fondateur des études italiennes à Belgrade), publié dans les années 1970. C’est ainsi que s’expliquent les nombreuses références à la figure de Dante, le « père de la nation italienne », dans un contexte que tous considéraient mûr pour suivre l’exemple des «maîtres» italiens qui étaient sur le point de récolter le fruit d’une difficile ascension vers une «primauté» qui se devait d’être «morale et civile». Il est impressionnant de voir, étant donné l’époque et les circonstances, le nombre de ceux qui se sont consacrés, avec des résultats parfois précieux, parfois pas tout à fait heureux, à la traduction – intégrale ou, plus souvent, partielle – de la Commedia. Ce qui est certain, c’est que des traces évidentes, parfois voilées, de l’œuvre de Dante sont identifiables dans le tissu de la production littéraire locale.
Ce phénomène de la prolifération des traductions de Dante, qui dura jusqu’au milieu du XXe siècle, eut le mérite d’ouvrir la voie pour d’autres auteurs classqiues. Ainsi, la première traduction du Decameron Boccace remonte aux années 1880 (elle doit être certainement attribuée aux frères Jovanović qui s’essayèrent aussi à la traduction du Melodramma de Metastasio). Peu de temps après parut une traduction de l’Orlando furioso de Ludovico Ariosto par D. Stanojević.
Le chemin parcouru prend des connotations beaucoup plus significatives lorsque, comme pour annoncer l’expérience de la revue « Pijemont » (périodique avec des contenus culturels, mais avec des références évidentes à l’imprimatur de la politique), l’attention pour les «classiques » se joint à celle pour les «contemporains». À ce stade, peut-être poussé par ses relations intenses avec Mazzini, S. Jovanović, illustre historien et très fin théoricien, a déjà œuvré pour rendre accessible de larges extraits du Prince de Machiavel. Mais ce sont surtout les «paroles en liberté» par les futuristes, le théâtre/métathéâtre de Pirandello, les nouvelles «véristes» de G. Verga (traduites et commentées par S. Matavulj) qui sont particulièrement suggestives.
La coexistence de «l’ancien» et du «nouveau» eût rapidement des effets non négligeables. À ce titre, le cas du prix Nobel I. Andrić est emblématique. Dans la retraite de Belgrade que lui imposait la guerre, Andrić s’était mis à parcourir et à traduire en serbe les Ricordi et la Storia d’Italia de F. Guicciardini ainsi que les rapports des ambassadeurs vénitiens. Cet ensemble d’ingrédients, savamment amalgamés, ont convergé aussi bien dans Ponte sulla Drina que dans les réflexions des Znakovi pored puta (la traduction des Ricordi sera publiée post mortem dans une édition critique commise par N. Stipčević).
Les tensions dues au conflit, si elles ont réussi à prendre le dessus pendant une courte période, ne semblent pas avoir entamé de manière irréparable ou irrémédiable ce lien solide, constitué au fil des décennies, entre la Serbie et l’Italie qui a montré qu’il était en mesure de surmonter jusqu’aux épreuves les plus difficiles. Malgré le poids, certes non négligeable, exercé par le climat de conflit idéologique dans lequel avait plongé tout le continent, les relations ouvertes entre les deux péninsules qui bordent l’Adriatique ont rapidement pris une place non négligeable. Il serait difficile d’en parler sans évoquer les efforts déployés en ce sens par les grands centres universitaires et leurs instituts respectifs de langue et littérature italiennes : celui de Zagreb, d’une part, et celui de Belgrade, de l’autre, tous deux engagés à encourager et à promouvoir des initiatives éditoriales louables, comme «Battana» à Fiume, appelée à devenir, avec l’aide de Rome, un lieu de rencontre privilégié entre écrivains italiens et yougoslaves. Or force est de constater que, pour la multiplication des contacts et des relations, le levier de la consommation de masse, qui a contribué à redessiner la physionomie de la société dans son ensemble, a été déterminant. La réinterprétation des «classiques», avec des versions plus abouties de la Commedia et du Decameron (sans parler de l’enthousiasme authentique qui entourait Pétrarque), et l’attention habituelle aux écrivains du moment (comme Moravia), est venue s’ajouter l’onde de choc omniprésente d’un phénomène auparavant absent : celui de la «littérature ambiante» (comme la définissait L. Simonetti), sans dorures, sans grandes prétentions, mais attestant aussi une proximité culturelle. Les exemples les plus sensationnels sont liés au monde de la bande dessinée : la diffusion des livres de Bonelli (de Zagor à Tex), et les succès obtenus par le duo Max Bunker – Magnus (Alan Ford, magistralement interprété par N. Briksi), sont même exceptionnels avec des tirages qui atteignent des niveaux inédits.
Le panorama des traductions de l’italien n’a pas subi de changement drastique après la disparition de la Fédération de Yougoslavie. Les dernières décennies se caractérisent par une offre abondantes de titres qui, si elle a su combler quelques lacunes fautives (comme, par exemple, les Novelle per un anno de Pirandello), a également contribué à enrichir les «bibliothèques de secteur» (de l’Histoire à la Philosophie en passant par les disciplines sociologiques). Mais il est important de souligner comment, à côté d’auteurs «valeurs sûres» (de U. Eco à C. Magris), l’intervention d’organismes et d’institutions, comme le ministère des Affaires étrangères ou l’IIC, est devenue un soutient présent, voire incontournable, à l’activité plus que louable de maisons d’édition émergentes et dynamiques, qui se donnent pour but de mettre à la disposition du grand public la voix de poètes ou d’écrivains méconnus.
C’est avec l’intention de fournir au lecteur un vrai instrument d’orientation, dans un cadre général qui a désormais atteint un haut degré de complexité et d’articulation, que les trois volumes Čitanje Italije (Lire l’Italie), dédiés aux récits, aux essais et à la poésie, ont été publiés. Fruit d’une collaboration entre l’IIC (dirigé à l’époque par D. Scalmani), le Département d’Études Italiennes et la maison d’édition Arhipelag la publication se veut une sorte d’anthologie visant à résumer le meilleur de la littérature italienne contemporaine aussi bien d’auteurs connus que plus «locaux» : une sorte d’aperçu bibliographique en forme d’aboutissement susceptible, toutefois, de devenir un point de départ.