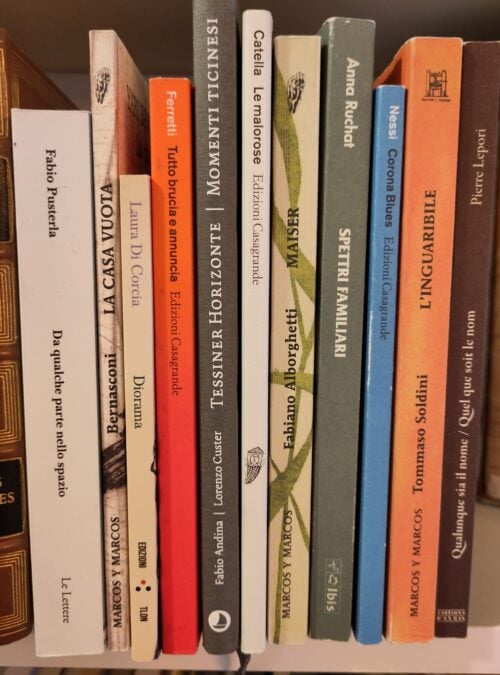Échos de Trieste dans l’édition française (première partie).
Auteur: Laurent Feneyrou (CNRS)

Or, en 1917, l’une des premières traductions françaises, publiée en Suisse et ingénieusement signée Tergestinus, d’un ouvrage triestin est L’Irrédentisme adriatique, dans lequel le journaliste et essayiste socialiste Angelo Vivante se montre soucieux de compromis, de protection des autonomies balkaniques et des intérêts des deux rives, l’italienne et la slave. Six ans après le suicide de Vivante, dont la tendance « presque a-nationale » ne pouvait accepter l’effondrement de son utopie, Benjamin Crémieux traduit, sous le titre Mon frère, le Carso (1921), le chef-d’œuvre de Scipio Slataper, une version rééditée dès la même année – le livre avait paru dans une relative indifférence en 1912, à la Libreria della Voce. L’auteur, tutélaire, incarnait le drame d’une génération née dans les dernières décennies du xixe siècle et promise au sacrifice sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, et pour Slataper, sur le mont Podgora, en 1915. De sa ville de naissance, celui-ci partageait les tensions et les contradictions la traversant, sinon la divisant, les valeurs et les tourments, une certaine marginalité au regard du reste de l’Italie, et la synthèse des reflets azurés de l’Adriatique et de la roche blanche du Carso, le haut plateau calcaire qui s’étend aux pieds des Alpes juliennes.
Comment dès lors définir la littérature triestine, sinon par ce visage simultanément composite, par cette « identité de frontière », comme l’écriront Angelo Ara et Claudio Magris ? D’autant que, en dépit des premiers romans d’Italo Svevo, celle-ci éclot en exil, à Florence, en 1909, sous la plume de Slataper, précisément, dans les pages de La Voce, puis avec le splendide Piccolo canzoniere in dialetto triestino de Virgilio Giotti, ces vers pici e tristi, mais aussi amoureux, édités en Toscane, en 1914, par Ferrante Gonnelli. Doit-on se limiter aux écrivains de la seule ville ou inclure, plus largement, ceux de la région. Mais jusqu’où ? dans ses tracés anciens ? Et d’ailleurs où se termine l’Italie ? avec l’Isonzo ? à Trieste ? au-delà ? En cette période de revendications, critères nationaux et considérations géographiques et militaires se mêlent confusément. Être originaire de Trieste est-il une condition suffisante pour se revendiquer de la littérature triestine ? N’y en a-t-il qu’une, celle d’une triestinità sciemment rendue étrangère à l’histoire ? Cette littérature est-elle le fait seulement de ceux qui s’expriment en italien ou en dialecte – mais que faire alors des extraordinaires vers slovènes de Srečko Kosovel, composés eux aussi sur le Carso, ou des romans, slovènes également, de Boris Pahor ou Alojz Rebula ? Et en quel dialecte : le triestino de Virgilio Giotti, Claudio Grisancich ou Manlio Malabotta, le gradese de Biagio Marin ou le rovignese de Ligio Zanini ? Ces dialectes ne sont aucunement vernaculaires, mais ductiles, archaïsants et modernes, aptes à unir la vie commune et le vers. Et ils ne sont pas, Pier Paolo Pasolini y insistera, langues ancillaires, secondaires, mais absolues, à l’occasion corrigées pour répondre aux exigences de la littérature. La poésie ne passe pas d’une langue majeure à une langue mineure, à un particularisme de région, de ville ou de quartier, ou pire, à une essence mythique de soi, ni même seulement à un lexique, riche d’échos vénitiens, slovènes, croates, austro-allemands, comme d’hellénismes et de latinismes. Tout poème ne nous met-il pas ainsi à l’écoute d’une langue autre, étrangère ?
Ce que les écrivains Ferruccio Fölkel et Carolus L. Cergoly appelleront, en austro-allemand, la Katastrophe, précipitée par la Première Guerre mondiale, avait déjà abouti à la désagrégation de l’Empire : « L’agonie des Habsbourg fut longue. La fin parut rapide. On déchira le drapeau jaune et noir, à l’aigle bicéphale, emblème de la Maison régnante. Hourra. À bas. 1382-1918. » Orpheline, sans guère d’industrie, coupée de son Hinterland, des marchés de la Carniole et d’anciens territoires plus lointains, Trieste meurt jeune, avec François-Joseph. Ou plutôt Trieste ne parvient pas à mourir. Le psychiatre Franco Basaglia, bien plus tard, le dira autrement : pour renaître, Trieste doit d’abord mourir ; elle se refuse pourtant à le faire.
Alors que le fascisme règne déjà en Italie, la France découvre Ettore Schmitz, alias Italo Svevo, grâce à Paul-Henri Michel, qui traduit Zéno (1927) et Sénilité (1930) – il faudra attendre les années 1960 avant de lire récits et nouvelles, et 1973 pour Une vie et les écrits intimes. Ensuite, par l’inlassable travail de Mario Fusco, les trois grands romans connaîtront une version aboutie. Comme Zeno qui ne savait pas choisir, maître de l’esquive et d’une indécision préservant les possibles, Svevo commerçait en austro-allemand, mais écrivait clandestinement en italien, certains de ses personnages, ultimes représentants de l’Ostjudentum, évoquant le fou meshuge. En connaisseur des méandres de l’âme, en poète ironique et tragique, lucide et cependant masqué, d’un sujet à son crépuscule, du malaise dans la civilisation et de la crise de la bourgeoisie, Svevo avait appris à James Joyce un trait de sa ville, d’une angoisse préludant au renoncement, à la dissolution, « la vie dans le compromis jusqu’à l’autodestruction ».
Après 1930, c’est un long silence. Les tragédies sur le chemin de la Seconde Guerre mondiale et pendant celle-ci se succèdent : la promulgation des lois raciales par Benito Mussolini, le 18 septembre 1938, sur la piazza Unità d’Italia, devant une foule en liesse, dans une ville qui compte la troisième et influente communauté juive du pays ; la rizière de San Sabba, seul camp d’extermination nazi en Méditerranée, où juifs, partisans et opposants politiques, italiens et slaves, moururent dans une chambre à gaz, sous les balles, des suites des tortures qu’ils subirent ou la nuque brisée par une lourde masse métallique ; les foibe, ces cavités naturelles dans la pierre carsique où furent assassinés des milliers de personnes, par les fascistes, mais aussi, lors d’une opération organisée par le maréchal Tito et visant à faire régner la terreur dans les populations italiennes de Vénétie Julienne et d’Istrie, et à liquider les opposants politiques yougoslaves. Car la guerre, à Trieste, ne s’achève pas en 1945. La partition de son « Territoire libre », créée par le Traité de Paris en 1947, place la ville jusqu’en 1954 sous une autorité anglo-américaine qui scrute l’horizon si proche, à portée de main, du bloc de l’Est.