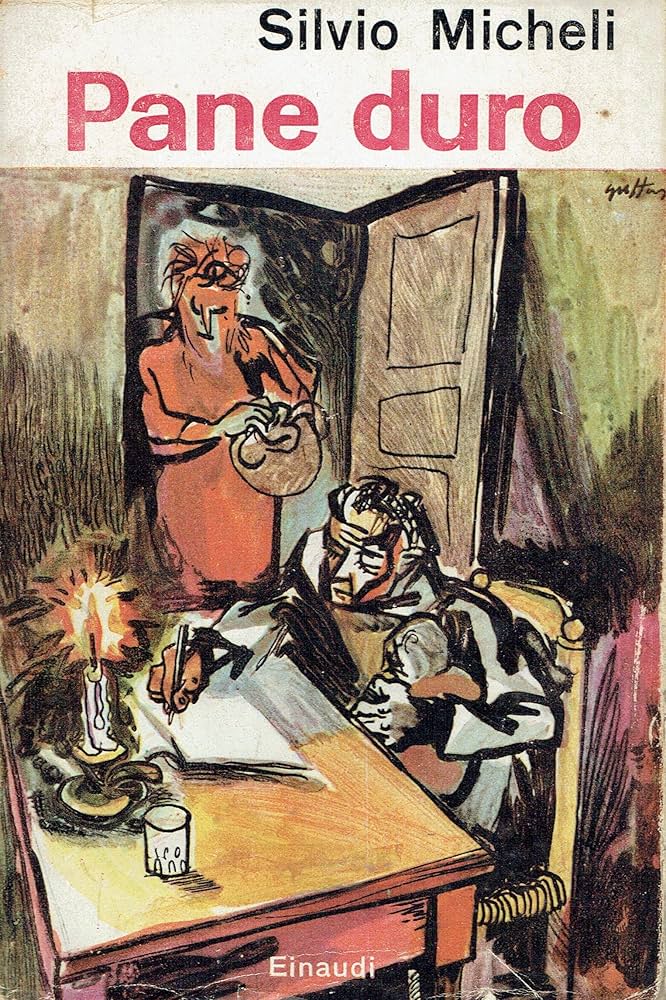Pane duro
Auteur: Jean-Pierre Pisetta
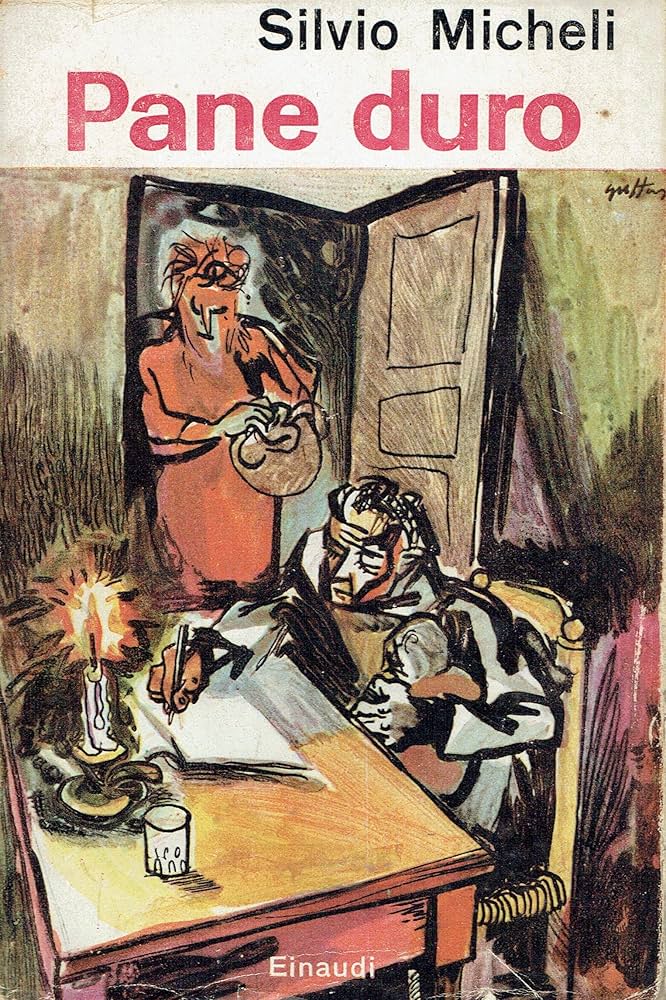
Un livre que j’aimerais traduire
newitalianbooks demande chaque mois à un traducteur de proposer un livre qu’il aimerait traduire.
Ce mois-ci, Jean-Pierre Pisetta présente :
Silvio Micheli, Pane duro, Torino, Einaudi, 1946
Il y a un peu moins d’un an, une amie turinoise qui sait que j’ai passé ma vie à traduire des textes délaissés m’envoie un article de journal traitant d’un auteur oublié. Son œuvre maîtresse, Pane duro (Le pain dur), aurait mérité, au moins elle, déplore le journaliste, une reconnaissance plus durable.
Mon amie ajoutait que cet article pourrait me donner des idées.
Le livre est introuvable, à part un exemplaire chez un antiquaire turinois à un prix excessif, à mes yeux, pour un auteur qui m’est tout à fait inconnu. En outre, le volume compte 633 pages. Cela vaut-il la peine de l’acheter « chat en poche » ? Et puis, moi qui ne traduis jamais sur commande, c’est-à-dire qui traduis d’abord des textes qui me plaisent avant de les proposer à des éditeurs, vais-je me lancer, sans un possible débouché, dans la traduction d’une telle brique ?
Non, je n’achète pas mais découvre le livre dans au moins deux bibliothèques turinoises et, devant séjourner prochainement Turin, je décide d’en profiter pour aller y lire les premiers chapitres. Je suis aussitôt happé par l’histoire de ce pauvre employé de bureau qui rêve de sortir de sa misère – et d’en tirer également sa femme et leur bébé – par l’écriture, car il a des talents littéraires (du moins en est-il persuadé) ce modeste gratte-papier !
De retour en Belgique, je me procure le volume dont j’ai à présent envie de lire toutes les 633 pages. Et, lorsque j’ai un peu de temps libre, j’en traduis une, jamais plus car je crains que ce texte – que j’ai lu avec bonheur –, que cette longue autofiction désespérée ne trouve jamais preneur dans l’édition française.
Mais bon ! une page de-ci de-là, le temps de siroter un café à ma table de travail, ça ne peut pas me faire de mal, si ce n’est à l’estomac (en cause le café, bien sûr, corsé de surcroît).
Jean-Pierre Pisetta
Jean-Pierre Pisetta est né en 1956 en Belgique de parents émigrés du Trentin. Après ses études secondaires, travaille quatre ans comme manœuvre. Ensuite, études supérieures de traduction, section russe-italien-français. Premier emploi d’enseignant en 1984, profession qu’il exercera jusqu’à sa retraite en 2021. En volume, première traduction (du russe) en 1986 (Léon Tolstoï, Contes et récits), première traduction de l’italien en 1990 (Gianni Vattimo, La société transparente), premier recueil de nouvelles personnelles en 1997 (Morts subites).
Ci-dessous, nous proposons un échantillon de traduction par Jean-Pierre Pisetta des toutes premières pages de Pane duro :
I
C’est certainement ainsi que ma mère aurait parlé. Moi, par contre, je ne me sentais pas taillé pour la vie de bureau. Dès que j’y pensais, j’entendais mon oreille résonner comme lorsque l’on y pose un coquillage vide ; ce terme était du venin, il m’étranglait, me faisait serrer les poings, m’aveuglait de larmes. Alors je voyais des milliers de kilomètres, je voyais loin, je voyais le soleil, la terre étendue comme un tapis, vibrant sous ses lumières, dans ses formes réchauffées par un feu déterré : le feu de Dieu qui resplendissait toujours au-delà de la fenêtre du bureau.
En vain le répétais-je à ma femme. Je le lui disais dans un long soupir, j’ouvrais les mains, je les levais, je les fermais, je hochais la tête : en vain, en vain. À mon fils, en revanche, je le susurrais en catimini, je disais : « Ah, si chacun pouvait faire ce pour quoi il est fait ! »
Mon fils ne disait ni oui ni non. Alors ma femme intervenait avec aigreur : « Arrête, ne fais pas l’imbécile. »
Elle me prenait le bébé des bras, tapait du pied, se retournait, toujours aussi revêche, et ajoutait : « File plutôt au bureau ! »
Voilà, moi je me serais bien rebellé et, exaspéré et furibond, je lui aurais dit : « Je le sais, je le sais, mais qu’est-ce que tu veux comprendre, toi ? Je le sais ce que toi tu voudrais. Je le sais bien. Évidemment que je le sais, ma femme. » Mais j’aurais aussitôt dû me taire, avaler ma salive, soupirer, m’attendant à la réponse, au regard de ma femme. Je toussais, je secouais la tête, la serrais, je crispais les poings, je regardais mes mains, mes pauvres mains, larges et écartées dans l’espace, pareilles à des feuilles d’automne.
Des feuilles d’automne se balançaient dans l’air cendré. Le vent faisait claquer des portes lointaines, s’acharnait sur les vitres : c’était un homme gris qui tendait sa main façonnée par la misère, il ne disait rien ; chaque jour, je l’attendais, je lui faisais un signe, un sourire fugace, amer. J’enfilais ma veste. Devant le miroir, minuscule et ébréché, je me léchais une main et, de cette main, rapidement les cheveux. « Je sais, je sais bien, grommelais-je, pourquoi tu ne comprends pas. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre ? »
Ma femme avait disparu. L’homme gris était là, lui, avec sa main tendue, avec ses yeux de bœuf, poussé par le vent, creusé par la misère, l’homme qui répétait chaque jour : « Un docteur, le temps est un grand docteur. »
Et moi je savais qu’il parlait pour moi et ça me faisait plaisir, ça me redonnait un peu de courage, délayait ce venin qui me serrait la gorge. Je descendais lentement les escaliers et je ressentais déjà l’âpre goût du soleil dans la rue, le contact avec une foule anonyme régentée par un trottoir sur lequel mon pas produirait un son étrange. Un désir fou m’incitait à remonter les quatre étages de cette maison décrépite d’une ville du Sud. Rentrer, courir vers la fenêtre et crier toute ma peine, toute mon oppression à la foule qui s’écoulait dans les rues. Sans respect pour les autres, sans retenue, montrer mon fils, montrer ma femme : « Oui, nous voici ! Et tout ça à cause de ma vie de bureau. Parce qu’à cette heure, oui, messieurs dames, nous aurions pu avoir des vêtements qui tueraient le froid, des fourrures pour ma femme, des habits pour mon petit et des amis fiers de nous. Et au lieu de ça nous voici, jour après jour, tous les jours pareils, la même garce de vie, la même souffrance que nous emporterons dans la tombe, dans la tombe que je vous dis ! »
C’est ça que j’aurais volontiers crié pour atténuer la peine qui me dévorait les entrailles, à la foule, sans respect des autres, d’homme à homme.
Je fermais les yeux à demi et je pensais. Je pensais à des choses bondissantes, de la couleur de l’arc-en-ciel. À des amis, que je pensais, qui répéteraient inconditionnellement : « Regardez, c’est lui, c’est vraiment lui ! »
Si Dieu était là, répétais-je en marchant vers le bureau, il devrait, c’est sûr qu’il devrait. Mais pourquoi, mais alors pourquoi ?
Je ne pouvais pas avouer ce tourment à ma femme, je ne pouvais pas l’avouer sans réserve, prévoyant sa réponse ; aussi la laissais-je le comprendre toute seule, sacrée femme, la mienne, plus sceptique que la foule massée dans les rues, toujours acariâtre et toujours défiante.
« Dépêche-toi parce que tu dois aller au bureau, au lieu de t’amuser à écrire. Tu n’attends quand même pas la fanfare ! »
« Je n’attends quand même pas la fanfare », répétais-je entre mes dents et j’aurais bien crié : « Au diable, au diable ! » Mais je ne criais pas, je me contentais de lever les yeux au ciel et je décrochais ma veste.
Les marches étaient faites de blocs de pierre très durs, usés au milieu, sales sur les côtés. Quand une porte claquait, l’écho se répercutait longuement dans le vide glacial de la cage d’escalier, il faisait aussitôt penser à une journée pluvieuse, sans lumière, à ma vie de bureau. « J’y vais bien sûr, que je disais, j’y vais, j’y vais, ne t’inquiète pas. Je vais au bureau, toute la vie, ma femme, je finirai ces tristes jours au bureau et personne ne saura jamais rien de moi. »
Les yeux de ma femme, je les sentais jusqu’à la porte d’entrée, jusque sur le trottoir et dans la rue. Ce n’était pas un regard lourd, en fait. Il me rappelait nos jours à nous ; les jours lointains, tracés d’une main enfantine, pleins de soleil et d’attentes, de nos années qui semblaient, alors, ne pas avoir de limites dans le temps. Aujourd’hui l’avenir pesait sur nous avec un regard curieux, il pesait sur moi avec le regard de ma femme.
Un jour, l’homme gris me dit : « Je pense ! »
Moi je lui répétais souvent dans un soupir : « Ah, si je pouvais faire ce pour quoi je suis fait ! »
Ma femme ne participait plus à ces soupirs. Elle ne me regardait même pas. Avant elle me regardait, fût-ce avec scepticisme et aigreur, c’était quelque chose et, parfois, elle souriait aussi.
Mon soupir refluait et s’enfonçait dans ma gorge telle l’eau d’une source dans la boue, le regard devenait absent, je pensais à des choses et je me sentais fatigué.
Il faisait très froid en ce temps-là et ça faisait pleurer le petit. Il était malade ; ma femme prenait cette attitude fermée qui semblait dire : tout est de ta faute. Ainsi le silence s’alourdissait-il de jour en jour dans l’espace, avec un effet de catastrophe imminente qui durcissait le sang à mes tempes. C’était de ma faute si l’enfant tombait malade ? Peut-être parce que je répétais que chacun devrait faire ce pour quoi il est fait ?
« Tout est de la faute de ton désastreux de père, semblait dire ma femme au petit, et de ses idées ! »
Parfois je me rebiffais rageusement : « Pas du tout ! Ce qu’il me faudrait, c’est du papier et un crayon et alors tu verrais ! »
Du papier et un crayon, disais-je, et je pensais à ma peine, à ma vie de bureau, à ma femme. Tout était sceptique et revêche, y compris l’homme gris qui tendait sa main rabougrie par le froid et la misère et qui disait dans le souffle du vent : « Jésus Marie ! »
Dans le petit kaléidoscope réapparaissaient les couleurs d’une angoisse qui se réduisait désormais à un tourment silencieux. J’ouvrais les mains, les refermais, les rouvrais et leur demandais : « Qui se battra avec moi ? »
Pour me rendre au bureau, je parcourais chaque jour la même rue arborée. Les arbres paraissaient à présent plus décharnés et plus tristes que moi. Un vent piquant les enveloppait l’un après l’autre en leur faisant pousser des gémissements que je comparais à la misère humaine et, dans les branches sèches hérissées contre le ciel, je voyais des bras tendus, des mains quêteuses aux coins des rues. L’homme gris, je ne le vis pas durant ces jours-là.
Sur le pavage désuni des trottoirs, mes pas résonnaient sèchement. Comme chaque jour, je m’arrêtais devant la vitrine d’une librairie regorgeant de lumière et de couleurs. Les muscles de mon visage se détendaient peu à peu quand mes yeux passaient en revue les belles couvertures, les phrases mises en relief, les couleurs sous lesquelles se dissimulait le mystère de mon tourment. Je souriais. Je redevenais sérieux. Je répétais mentalement les noms les plus doux, imprimés en gras, je penchais la tête, je regardais de biais, je riais et je redevenais sérieux. Je posais la main sur la vitre soigneusement nettoyée. La main que je passerais volontiers sur ces pages qui sentaient l’imprimerie, sur les couleurs vives, ces couleurs que je voyais en fermant les yeux à demi. Et en fermant les yeux à demi, je m’éloignais comme par enchantement des rancœurs sourdes de la misère humaine, alors la voix de l’homme gris me caressait elle aussi l’oreille et disait : « Le bonheur vaut plus que la richesse. » Et moi je souriais, mais ensuite je redevenais sérieux devant la pile des volumes qui ressemblait à une girandole au-delà de la vitre sur laquelle mon haleine dessinait un cercle opaque.
– Bonjour, monsieur, me dit l’homme distingué en se penchant sur le seuil de la librairie. Je vous en prie, je vous en prie, monsieur.
Je regardai l’homme distingué, son col amidonné, ses mains blanches, desséchées, ornées de bagues. C’était certainement le propriétaire des livres, il souriait.
– Je vous en prie, entrez donc.
Il m’avait poussé légèrement comme s’il feuilletait un des livres à la couleur mystérieuse. Je ne m’opposai pas. J’entrai comme on entre après de nombreuses années dans une vieille église de village. Des étagères bondées de volumes attirèrent mon regard dans chaque coin. Flottait dans la pièce une forte odeur d’imprimerie, de papier pressé qui rappelait celle de mes premiers livres d’école lorsque, tout jeune, la langue entre les dents, je coupais les pages avec une agitation indéfinissable.
Le monsieur distingué, qui frottait ses mains baguées, me demanda en se courbant avec douceur :
– Un beau roman ?
Je souris. Je pensai sincèrement à un beau roman. Dans l’air, le parfum de papier imprimé devint plus prononcé, plus dense l’amalgame des couleurs qui tournait comme un moulin d’enfant entre les étagères.
– Un chef-d’œuvre, nous en sommes à la vingtième édition, disait le monsieur tandis que, de sa main baguée, il tapotait la couverture pour en chasser la poussière.
Je pris le volume et le tins avec délicatesse. Je le soupesai, le retournai, le caressai. La forte odeur d’imprimerie montait des mots nets et luisants qui couvraient les pages que je tournais çà et là. Je lus deux lignes, je souris ; je lus plus avant puis refermai le livre. La main baguée du monsieur dit :
– Je crois avoir compris. Je reviens de suite.
Je m’approchai des livres qui remplissaient la première étagère et commençai à lire les titres l’un après l’autre. De vieux livres, sentant la poussière, des livres épais où se cachait la sagesse incroyable d’auteurs que je voyais courbés par le poids d’une barbe blanche.
– Voilà, monsieur, ce livre s’est vendu comme des petits pains. Un livre extraordinaire. Connaissez-vous l’auteur ?
Je ne connaissais ni cet auteur ni celui d’une douzaine de romans que le monsieur distingué me présenta en allant et venant entre les étagères.
– Peut-être désirez-vous des romans policiers ? Des livres d’aventures ? Que désirez-vous, monsieur ?
Quand j’étais petit, ma mère me répétait : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. » Un jour, ma femme aussi avait dit des choses semblables, peut-être quand j’étais assis devant ma table à écrire toute vermoulue et déglinguée. Puis elle avait cessé de dire également ça. Maintenant elle ne disait plus rien. Elle travaillait toute la journée, rapiéçait, reprisait, s’occupait du petit et soupirait longuement. Parfois, elle disait, dure et revêche : « Dieu seul sait comment on fera pour arriver à la fin du mois. » Alors je marchais vers le bureau. Je n’écoutais plus la voix douce du monsieur distingué. Je marchais sur le pavage sec du trottoir tandis que le vent gémissait entre les branches des arbres appauvris. Je marchais et je pensais, intensément même que je pensais, les yeux remplis d’une girandole aux couleurs les plus vives et au parfum de papier fraîchement imprimé.